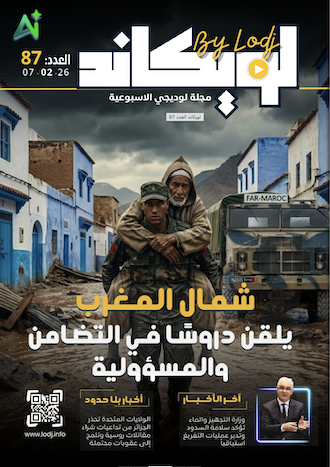Après la chute de Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu, à l’Est de la République démocratique du Congo (RDC), investie le 26 janvier par les combattants rebelles du Mouvement du 23 mars (M23), c’est au tour de Bukavu, 2ème plus grande ville de ladite province, d’être capturée, le 14 février, par les rebelles congolais, soutenus par le Rwanda.
L’information a été confirmée à l’agence de presse française AFP par Corneille Nangaa, chef de l’Alliance du fleuve Congo (AFC), dont fait partie le M23.
Les rebelles du M23 avaient pourtant annoncé, le 3 février, un cessez-le-feu unilatéral pour des raisons humanitaires, que le gouvernement congolais avait qualifié, le lendemain, de « fausse communication ».
Lawrence Kanyuka, porte-parole des rebelles du M23, avait même déclaré : « il doit être clair que nous n’avons aucune intention de prendre Bukavu ou d’autres zones ».
L’information a été confirmée à l’agence de presse française AFP par Corneille Nangaa, chef de l’Alliance du fleuve Congo (AFC), dont fait partie le M23.
Les rebelles du M23 avaient pourtant annoncé, le 3 février, un cessez-le-feu unilatéral pour des raisons humanitaires, que le gouvernement congolais avait qualifié, le lendemain, de « fausse communication ».
Lawrence Kanyuka, porte-parole des rebelles du M23, avait même déclaré : « il doit être clair que nous n’avons aucune intention de prendre Bukavu ou d’autres zones ».
Effondrement de l’armée de la RDC
Malgré l’intervention de l’aviation militaire, l’armée de la RDC (FARDC) semble dans l’incapacité de stopper l’élan des combattants du M23, soutenus par quelques 4.000 soldats rwandais. Ces derniers semblent autrement plus combattifs et efficaces que les mercenaires roumains à la solde de la RDC, qui se sont rendus massivement lors de la prise de Goma.
Le président de la RDC, Felix Tshisekedi, rentré à Kinshasa en catastrophe de Munich, ou il assistait à une conférence sur la sécurité, a vertement critiqué la communauté internationale, incapable selon lui, d’arrêter l’avance des troupes rebelles et rwandaises dans l’Est de son pays.
« Cela pose la question des Nations unies, qui sont devenues pour moi une organisation à deux vitesses selon que l'on fait partie des (pays) puissants ou privilégiés ou que l'on fait partie des (pays) faibles et défavorisés », a-t-il déclaré.
12 casques bleus des Forces de réaction rapide, unité d’élite de la Mission de l’Organisation des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (Monusco), sont, pourtant, tombés au combat en défendant Goma.
Le président de la RDC, Felix Tshisekedi, rentré à Kinshasa en catastrophe de Munich, ou il assistait à une conférence sur la sécurité, a vertement critiqué la communauté internationale, incapable selon lui, d’arrêter l’avance des troupes rebelles et rwandaises dans l’Est de son pays.
« Cela pose la question des Nations unies, qui sont devenues pour moi une organisation à deux vitesses selon que l'on fait partie des (pays) puissants ou privilégiés ou que l'on fait partie des (pays) faibles et défavorisés », a-t-il déclaré.
12 casques bleus des Forces de réaction rapide, unité d’élite de la Mission de l’Organisation des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (Monusco), sont, pourtant, tombés au combat en défendant Goma.
Phénoménale incompétence
Arrivé au pouvoir le 25 janvier 2019, c’est-à-dire près de trois ans avant que le M23, crée en mai 2012 et réactivé en novembre 2021, ne reprenne les armes, Felix Tshisekedi ne remet nullement en question l’échec de sa gestion politique et militaire du conflit.
Comment est-ce qu’un pays, la RDC, qui compte une population de 109,7 millions d’habitants et une armée de 166.700 soldats, se fait-il malmener par une coalition politico-militaire, l’Alliance fleuve Congo, regroupement hétéroclite de 17 partis politiques et d’une centaine de bandes armées, dont la principale composante, le M23, ne dispose pourtant pas plus de 8.000 combattants ?
Il est à rappeler que les FARDC sont appuyés par 15.000 casques bleus et 2.900 soldats sud-africains.
Le Rwanda, qui soutient ladite rébellion, selon plusieurs rapports de l’Onu, n’est lui-même qu’un pays d’à peine 13,9 millions d’habitants et dont l’effectif de l’armée ne dépasse pas les 33.000 soldats.
Comment est-ce qu’un pays, la RDC, qui compte une population de 109,7 millions d’habitants et une armée de 166.700 soldats, se fait-il malmener par une coalition politico-militaire, l’Alliance fleuve Congo, regroupement hétéroclite de 17 partis politiques et d’une centaine de bandes armées, dont la principale composante, le M23, ne dispose pourtant pas plus de 8.000 combattants ?
Il est à rappeler que les FARDC sont appuyés par 15.000 casques bleus et 2.900 soldats sud-africains.
Le Rwanda, qui soutient ladite rébellion, selon plusieurs rapports de l’Onu, n’est lui-même qu’un pays d’à peine 13,9 millions d’habitants et dont l’effectif de l’armée ne dépasse pas les 33.000 soldats.
La malédiction des richesses minières
Le Rwanda a encaissé, en 2023, un montant record de 1,1 milliards de dollars grâce à l’exportation de trois minéraux stratégiques, le coltan, dont il est le premier exportateur mondial, ainsi que de l’étain et le tungstène (appelés les « minerais 3T »).
Selon une étude publiée, en 2022, par l’Ong britannique Global Witness, spécialisée dans la lutte contre le pillage des ressources naturelles des pays en développement, 90% du volume des « minerais 3T » exportés par le Rwanda seraient introduits illégalement à partir de la RDC.
« Le Congo (NDLR : la RDC) est tout à fait singulier, avec un sous-sol qui contient de très grandes quantités de cuivre, nickel, cobalt, manganèse, germanium (entre autres), indispensables aux nouvelles technologies », explique Fabien Lebrun, sociologue qui effectue des recherches sur les impacts écologiques et géopolitiques des nouvelles technologies, dans un entretien accordé au média français « Basta ».
« C’est comme si la révolution numérique était enfouie sous la terre congolaise », a-t-il ajouté.
Sauf que cette « bénédiction géologique », qui attise les appétits financiers et géopolitiques, s’est transformée en malédiction pour les Congolais.
« Dans ce pays, qui regorge de matières premières indispensables à l’industrie numérique, les dommages humains et environnementaux dépassent l’entendement », indique le sociologue français.
Selon une étude publiée, en 2022, par l’Ong britannique Global Witness, spécialisée dans la lutte contre le pillage des ressources naturelles des pays en développement, 90% du volume des « minerais 3T » exportés par le Rwanda seraient introduits illégalement à partir de la RDC.
« Le Congo (NDLR : la RDC) est tout à fait singulier, avec un sous-sol qui contient de très grandes quantités de cuivre, nickel, cobalt, manganèse, germanium (entre autres), indispensables aux nouvelles technologies », explique Fabien Lebrun, sociologue qui effectue des recherches sur les impacts écologiques et géopolitiques des nouvelles technologies, dans un entretien accordé au média français « Basta ».
« C’est comme si la révolution numérique était enfouie sous la terre congolaise », a-t-il ajouté.
Sauf que cette « bénédiction géologique », qui attise les appétits financiers et géopolitiques, s’est transformée en malédiction pour les Congolais.
« Dans ce pays, qui regorge de matières premières indispensables à l’industrie numérique, les dommages humains et environnementaux dépassent l’entendement », indique le sociologue français.
Massacre sous-médiatisé
Près de 3,9 millions de personnes ont perdu la vie suite aux deux premières guerres du Congo (1996-1997 et 1998-2003). Les récents combats dans la province du Nord-Kivu ont fait quelques 3.000 morts, outre quelques 350.000 de personnes ayant perdu leurs foyers en fuyant les affrontements, qui viennent s’ajouter aux près de 7 millions de déplacés internes des précédentes guerres.
Et c’est à peine si l’on entend parler dans les médias.
A chaque fois que vous consultez votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur portable, une petite pensée pour les victimes des sanglants massacres en RDC.
Et c’est à peine si l’on entend parler dans les médias.
A chaque fois que vous consultez votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur portable, une petite pensée pour les victimes des sanglants massacres en RDC.












 L'accueil
L'accueil