Quand les écrans remplacent la parole, et que l’algorithme redessine les liens familiaux
Autour d’une même table familiale, un adolescent qui scrolle TikTok, une mère qui transfère des messages WhatsApp, un père silencieux qui zappe entre chaînes TV, un grand-père qui ne comprend plus le monde qui l’entoure… Cette scène est devenue banale au Maroc. La révolution numérique, si elle a rapproché les gens virtuellement, a aussi creusé un fossé générationnel. Un fossé qui ne se mesure pas seulement en méga-octets, mais en malentendus, en isolement, en incompréhension mutuelle.
Une génération née avec l’écran dans la main
Les jeunes Marocains, notamment ceux nés après 2000, n’ont pas connu un monde sans Internet. Leur univers est façonné par les réseaux sociaux, les stories, les filtres, les influenceurs, les trends, les likes et les algorithmes. Leur langage est visuel, instantané, souvent anglicisé. Leur rythme est rapide, zappant d’une vidéo à l’autre, d’un sujet à l’autre.
“Quand je parle à mon père, j’ai l’impression qu’il vient d’une autre planète. Il veut que je lise le journal papier… moi je lis tout sur Instagram ou Reddit”, raconte Yassine, 17 ans.
Des parents dépassés, mais encore influents
Les parents marocains, surtout ceux des classes moyennes et populaires, ont été surpris par la rapidité de cette révolution. Beaucoup ont découvert Internet après leurs enfants. Leur maîtrise reste partielle : WhatsApp, Facebook, parfois YouTube. Mais les plateformes comme TikTok, Snapchat, Twitch ou Discord leur sont étrangères.
Résultat : les parents ne comprennent pas ce que consomment leurs enfants. Et les enfants ne comprennent pas pourquoi leurs parents s’inquiètent autant.
Ce décalage crée une rupture dans la communication :
– Les uns veulent parler.
– Les autres répondent par des émojis.
– Chacun reste dans sa bulle.
Les grands-parents, grands exclus du numérique
La fracture numérique ne s’arrête pas entre parents et enfants. Elle se creuse encore plus avec les personnes âgées. Peu d’entre elles ont accès à Internet, et encore moins en comprennent les usages. Résultat : elles sont marginalisées dans un monde où tout se fait en ligne (rendez-vous médicaux, démarches administratives, nouvelles, photos de famille, etc.).
Et cette exclusion n’est pas que technologique : elle est affective.
Un grand-père qui ne voit plus les photos de ses petits-enfants. Une grand-mère qui ne sait pas ce que signifie "mode avion"… Ce sont des êtres que l’on coupe doucement du monde.
Des conséquences sur la cohésion familiale
Le numérique, s’il n’est pas accompagné, peut désarticuler la cellule familiale.
– Le repas n’est plus un moment d’échange, mais un moment d’écran.
– Le salon n’est plus un lieu commun, mais un point de connexion Wi-Fi.
– Les sujets de conversation deviennent étrangers : "tu ne peux pas comprendre, maman".
La famille marocaine, autrefois très soudée autour de la parole, du récit oral, de la transmission directe, est désormais morcelée. Chacun dans sa chambre. Chacun avec son écran.
Le paradoxe : hyperconnectés, mais seuls
Les jeunes Marocains sont ultraconnectés. Mais aussi ultrasolaires.
Ils peuvent passer des heures à discuter avec des inconnus, sans dire un mot à leurs proches.
Et dans les familles, ce silence numérique devient une forme de distance émotionnelle.
“Ma fille me montre ses vidéos sur TikTok… mais elle ne m’a jamais parlé de ses peurs, de ses rêves”, témoigne Halima, 45 ans.
Le numérique n’est pas le mal. Mais l’absence de médiation le rend destructeur.
Que faire ? Reconnecter les générations
Écouter les jeunes sur leur univers numérique
Au lieu de critiquer, essayer de comprendre ce qu’ils aiment, ce qu’ils suivent, pourquoi.
Partager ses propres usages
Montrer qu’on peut aussi apprendre, s’adapter, évoluer.
Créer des moments sans écran
Des repas, des balades, des discussions, sans téléphone sur la table.
Former les grands-parents
Avec des ateliers simples pour utiliser WhatsApp, faire un appel vidéo, consulter la météo.
Donner du sens à l’usage
Apprendre à vérifier l’information, à protéger sa vie privée, à éviter l’addiction.
Témoignages : vers une nouvelle entente numérique
– Najib, 52 ans, père de deux ados :
“J’ai installé TikTok pour comprendre ce qui les intéresse. Maintenant on échange des vidéos. Ça crée un lien.”
– Fatima, 67 ans, Casablanca :
“Ma petite-fille m’a appris à envoyer des messages vocaux. J’ai retrouvé le goût de parler.”
– Omar, 21 ans, étudiant :
“Mon grand-père ne comprend rien à mon téléphone. Mais je lui lis les infos à haute voix chaque matin. C’est notre moment à nous.”
Le rôle de la culture et de la spiritualité
Dans la tradition marocaine, la transmission se faisait par le regard, la parole, la présence.
Or, aujourd’hui, cette chaîne est menacée. Il est temps de redonner une place à l’humain dans la technologie.
Le Coran insiste sur l’importance de l’écoute, du respect des aînés, du dialogue intergénérationnel.
Rester humain dans un monde numérique, c’est respecter les rythmes, les silences, les moments.
Le vrai réseau, c’est la famille
Les likes, les vues, les abonnés, ne remplacent pas la chaleur d’un regard, la main d’un parent, ou le rire partagé autour d’un thé.
Le défi du Maroc d’aujourd’hui n’est pas seulement de connecter ses écoles ou ses administrations.
C’est de reconnecter ses cœurs, ses générations, ses foyers.
Et cela commence par une question simple : "Est-ce que je suis vraiment là… quand je suis connecté ?"
Autour d’une même table familiale, un adolescent qui scrolle TikTok, une mère qui transfère des messages WhatsApp, un père silencieux qui zappe entre chaînes TV, un grand-père qui ne comprend plus le monde qui l’entoure… Cette scène est devenue banale au Maroc. La révolution numérique, si elle a rapproché les gens virtuellement, a aussi creusé un fossé générationnel. Un fossé qui ne se mesure pas seulement en méga-octets, mais en malentendus, en isolement, en incompréhension mutuelle.
Une génération née avec l’écran dans la main
Les jeunes Marocains, notamment ceux nés après 2000, n’ont pas connu un monde sans Internet. Leur univers est façonné par les réseaux sociaux, les stories, les filtres, les influenceurs, les trends, les likes et les algorithmes. Leur langage est visuel, instantané, souvent anglicisé. Leur rythme est rapide, zappant d’une vidéo à l’autre, d’un sujet à l’autre.
“Quand je parle à mon père, j’ai l’impression qu’il vient d’une autre planète. Il veut que je lise le journal papier… moi je lis tout sur Instagram ou Reddit”, raconte Yassine, 17 ans.
Des parents dépassés, mais encore influents
Les parents marocains, surtout ceux des classes moyennes et populaires, ont été surpris par la rapidité de cette révolution. Beaucoup ont découvert Internet après leurs enfants. Leur maîtrise reste partielle : WhatsApp, Facebook, parfois YouTube. Mais les plateformes comme TikTok, Snapchat, Twitch ou Discord leur sont étrangères.
Résultat : les parents ne comprennent pas ce que consomment leurs enfants. Et les enfants ne comprennent pas pourquoi leurs parents s’inquiètent autant.
Ce décalage crée une rupture dans la communication :
– Les uns veulent parler.
– Les autres répondent par des émojis.
– Chacun reste dans sa bulle.
Les grands-parents, grands exclus du numérique
La fracture numérique ne s’arrête pas entre parents et enfants. Elle se creuse encore plus avec les personnes âgées. Peu d’entre elles ont accès à Internet, et encore moins en comprennent les usages. Résultat : elles sont marginalisées dans un monde où tout se fait en ligne (rendez-vous médicaux, démarches administratives, nouvelles, photos de famille, etc.).
Et cette exclusion n’est pas que technologique : elle est affective.
Un grand-père qui ne voit plus les photos de ses petits-enfants. Une grand-mère qui ne sait pas ce que signifie "mode avion"… Ce sont des êtres que l’on coupe doucement du monde.
Des conséquences sur la cohésion familiale
Le numérique, s’il n’est pas accompagné, peut désarticuler la cellule familiale.
– Le repas n’est plus un moment d’échange, mais un moment d’écran.
– Le salon n’est plus un lieu commun, mais un point de connexion Wi-Fi.
– Les sujets de conversation deviennent étrangers : "tu ne peux pas comprendre, maman".
La famille marocaine, autrefois très soudée autour de la parole, du récit oral, de la transmission directe, est désormais morcelée. Chacun dans sa chambre. Chacun avec son écran.
Le paradoxe : hyperconnectés, mais seuls
Les jeunes Marocains sont ultraconnectés. Mais aussi ultrasolaires.
Ils peuvent passer des heures à discuter avec des inconnus, sans dire un mot à leurs proches.
Et dans les familles, ce silence numérique devient une forme de distance émotionnelle.
“Ma fille me montre ses vidéos sur TikTok… mais elle ne m’a jamais parlé de ses peurs, de ses rêves”, témoigne Halima, 45 ans.
Le numérique n’est pas le mal. Mais l’absence de médiation le rend destructeur.
Que faire ? Reconnecter les générations
Écouter les jeunes sur leur univers numérique
Au lieu de critiquer, essayer de comprendre ce qu’ils aiment, ce qu’ils suivent, pourquoi.
Partager ses propres usages
Montrer qu’on peut aussi apprendre, s’adapter, évoluer.
Créer des moments sans écran
Des repas, des balades, des discussions, sans téléphone sur la table.
Former les grands-parents
Avec des ateliers simples pour utiliser WhatsApp, faire un appel vidéo, consulter la météo.
Donner du sens à l’usage
Apprendre à vérifier l’information, à protéger sa vie privée, à éviter l’addiction.
Témoignages : vers une nouvelle entente numérique
– Najib, 52 ans, père de deux ados :
“J’ai installé TikTok pour comprendre ce qui les intéresse. Maintenant on échange des vidéos. Ça crée un lien.”
– Fatima, 67 ans, Casablanca :
“Ma petite-fille m’a appris à envoyer des messages vocaux. J’ai retrouvé le goût de parler.”
– Omar, 21 ans, étudiant :
“Mon grand-père ne comprend rien à mon téléphone. Mais je lui lis les infos à haute voix chaque matin. C’est notre moment à nous.”
Le rôle de la culture et de la spiritualité
Dans la tradition marocaine, la transmission se faisait par le regard, la parole, la présence.
Or, aujourd’hui, cette chaîne est menacée. Il est temps de redonner une place à l’humain dans la technologie.
Le Coran insiste sur l’importance de l’écoute, du respect des aînés, du dialogue intergénérationnel.
Rester humain dans un monde numérique, c’est respecter les rythmes, les silences, les moments.
Le vrai réseau, c’est la famille
Les likes, les vues, les abonnés, ne remplacent pas la chaleur d’un regard, la main d’un parent, ou le rire partagé autour d’un thé.
Le défi du Maroc d’aujourd’hui n’est pas seulement de connecter ses écoles ou ses administrations.
C’est de reconnecter ses cœurs, ses générations, ses foyers.
Et cela commence par une question simple : "Est-ce que je suis vraiment là… quand je suis connecté ?"
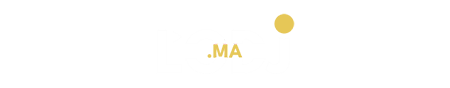











 L'accueil
L'accueil


























