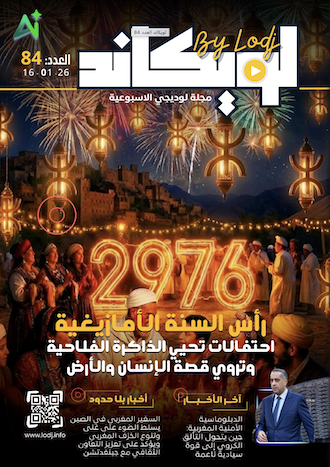Par Adnan Debbarh
Mais derrière cette solidité analytique affleure une limite persistante dans la production stratégique nationale : l’incapacité à structurer une pensée de l’action extérieure, à formuler des priorités claires, à assumer une doctrine lisible. Ce déficit de cap n’est pas conjoncturel. Il reflète une culture de la prudence méthodique, où l’on préfère accumuler des diagnostics plutôt que de choisir une direction.
Cette accumulation de rapports sans cap ressemble à un navigateur qui cartographie chaque vague sans jamais choisir entre l’Atlantique et la Méditerranée. Résultat : on épuise l’équipage en zigzags, tandis que d’autres voguent vers leur destination.
Face aux recompositions brutales de l’ordre international, ce modèle atteint ses limites. Le Maroc ne peut plus se contenter de "gérer les incertitudes" : il doit les orienter.
Le rapport de l’IRES analyse les effets de la montée des BRICS+ sur la gouvernance mondiale, identifie les relais économiques potentiels (hydrogène vert, corridors logistiques, gazoduc Nigéria–Maroc) et compare les positionnements marocains entre G7 et BRICS. Toutefois, il évite les choix structurants.
À aucun moment, une ligne stratégique claire n’est formulée :
Le Maroc veut-il rejoindre les BRICS+ ? Les influencer de l’extérieur ? Jouer un rôle pivot entre blocs ? Quels partenaires faut-il privilégier, selon quels critères ?
La seule piste proposée, celle d’une « distance tactique », sonne comme une esquive. Or une tactique n’est pas une stratégie.
Un think tank de qualité ne peut se contenter de décrire. Il doit penser, hiérarchiser, projeter.
A bien y regarder, cette prudence analytique a un coût, elle laisse intacts plusieurs points aveugles, pourtant cruciaux pour toute stratégie à l’égard des BRICS+. Qu’il nous soit permis de citer cinq.
L’absence d’une doctrine africaine articulée. Malgré une analyse détaillée de plusieurs relations bilatérales (Afrique du Sud, Éthiopie, Nigéria), le rapport ne formule pas de vision africaine unifiée. Aucun critère de hiérarchisation des alliances, aucune projection institutionnelle à l’échelle continentale. Or l’Afrique n’est pas une zone d’opportunité : elle doit devenir un axe de projection stratégique structuré.
Une diplomatie économique sans doctrine exportatrice.
L’étude mentionne les investissements marocains, les flux commerciaux ou les corridors Sud–Sud. Mais elle ignore les déséquilibres structurels du commerce extérieur, la faible intégration des PME, l’absence de politique industrielle tournée vers l’export. Une stratégie BRICS+ ne peut faire l’économie d’un cap économique cohérent.
Le soft power marocain, un levier oublié. L’IRES analyse le soft power des BRICS+, mais n’examine jamais celui du Maroc. Aucune mention du potentiel diplomatique des élites africaines formées dans les universités marocaines, de la présence culturelle régionale, de l’islam modéré ou des médias comme outils d’influence. Dans un monde de perceptions, cette omission est stratégique. Prenons un exemple emblématique : le Maroc forme chaque année 5 000 étudiants subsahariens, mais combien deviennent des relais actifs de notre influence dans les capitales BRICS+ comme Pretoria ou New Delhi ?
Aucun dispositif systématique ne capitalise sur ce vivier, alors que la Chine suit méticuleusement ses diplômés africains via ses 'Alumni Networks'.
Un découplage entre finance et économie réelle. La réussite des banques marocaines en Afrique est saluée, mais l’absence de liens structurés entre cette présence financière et l’économie productive n’est pas interrogée. Or sans projection industrielle, l’influence financière reste un signal faible. Le Maroc gagnerait à aligner sa puissance bancaire sur une ambition productive partagée.
Aucune articulation avec les réformes internes. Le rapport pense la stratégie BRICS+ comme un enjeu extérieur. Mais la crédibilité internationale du Maroc dépend aussi de sa capacité à réformer : fiscalité, éducation, justice, attractivité IDE. Sans cohésion interne, sans souveraineté industrielle ou énergétique, aucun alignement stratégique durable n’est possible.
Ces impensés stratégiques révèlent un vide, celui d’un projet lisible. Toute nation qui aspire à compter dans un nouvel ordre mondial doit assumer une ligne directrice. Pour le Maroc, on l’a déjà proposé, cette ligne pourrait s’articuler autour d’un triptyque.
Souveraineté : non comme fermeture, mais comme capacité à arbitrer ses interdépendances, à garantir des marges d’autonomie sur l’énergie, l’alimentation, la monnaie, le numérique.
Projection : non comme activisme désordonné, mais comme diplomatie de proposition, portée par des coalitions choisies, des relais narratifs, des outils d’influence. Cette projection doit s'incarner dans des outils concrets : un 'BRICS+ Policy Lab' marocain pour décrypter les normes émergentes du groupe, un fonds dédié aux joint-ventures avec l'Inde dans les biotech, ou encore un sommet annuel 'Maroc-Afrique-BRICS' à dans une ville emblématique du Sud marocain pour peser sur l'agenda du Sud global.
Cohésion : non comme discours nationaliste, mais comme condition de crédibilité externe. Il n’y a pas de diplomatie forte sans cohésion sociale, ni de puissance sans projet intérieur partagé. Ce cadre offre une boussole doctrinale pour guider les décisions stratégiques, y compris face aux BRICS+. Il permet de sortir des alliances affectives (Europe comme partenaire naturel, Chine comme puissance amie, Russie comme pôle alternatif) pour entrer dans une lecture adulte, contractuelle et différenciée des rapports internationaux.
Il faut penser le monde en architecte, non en arpenteur. Certains objecteront qu'une doctrine bridera notre flexibilité. Ils se trompent : regardez la Turquie. Son 'Afro-Asianism' affiché lui permet de négocier à la fois avec les BRICS et l'OTAN, tout en vendant des drones à l'Afrique. La clarté n'enferme pas, elle libère.
Le Maroc est aujourd’hui à un tournant. Il dispose d’atouts considérables, mais aussi de contraintes structurelles. Dans un monde où les blocs se recomposent, où la normativité occidentale recule et où les BRICS+ cherchent à se définir, l’opportunité est réelle, à condition d’y entrer avec une doctrine claire.
L’IRES a livré un travail sérieux. Mais il reste prisonnier d’un cadre analytique où la prudence intellectuelle étouffe la clarté stratégique. Le moment est venu d’exiger plus. Non pas plus de données, mais plus de vision. Non pas plus de scénarios, mais un cap.
Le Maroc ne pourra s’imposer dans les rapports de puissance mondiaux que s’il assume enfin une pensée stratégique adulte, cohérente et articulée.












 L'accueil
L'accueil





 Conseil de la Paix, le pari de Pascal du Maroc
Conseil de la Paix, le pari de Pascal du Maroc