En 2024, les levées de fonds sur le marché de la dette privée au Maroc ont connu une croissance soutenue. Selon le rapport de l’AMMC, le montant global levé par émissions obligataires et instruments de dette négociable (TCN) a atteint 60,4 milliards de dirhams, en progression de 16,8 % par rapport à 2023. À première vue, cette dynamique semble témoigner de la vitalité du financement non bancaire. Mais à y regarder de plus près, le marché reste très concentré et déséquilibré.
Des banques omniprésentes
Le secteur financier continue de dominer outrageusement les levées de dette : les banques et organismes financiers représentent 70 % des montants levés. Ce sont eux qui ont le plus souvent recours aux obligations subordonnées, aux TCN ou aux placements privés pour optimiser leur structure de capital ou financer leur croissance.
À l’inverse, la part des entreprises industrielles, commerciales ou technologiques dans ces opérations reste marginale. L’usage du marché obligataire demeure une affaire d’initiés, souvent réservé aux grands groupes structurés, avec notation de crédit et relations solides avec les investisseurs.
Des instruments techniques, peu accessibles au grand public
La montée en puissance de produits comme les obligations perpétuelles ou les TCN à court terme illustre la sophistication croissante du marché. Mais cette complexité éloigne les PME ou les collectivités locales, qui pourraient pourtant bénéficier de ce mode de financement désintermédié.
De plus, ces instruments sont rarement ouverts à l’épargne des particuliers, ce qui accentue la déconnexion entre les besoins de financement de l’économie réelle et les circuits disponibles pour l’investissement citoyen.
Vers une meilleure structuration ?
Pour rendre le marché plus inclusif, certains appellent à :
Créer des fonds spécialisés dans la dette privée des PME, garantis partiellement par l’État.
Simplifier l’émission de mini-obligations ou de TCN dédiés aux collectivités.
Améliorer la lisibilité des offres de dette pour les non-initiés, y compris via la cotation.
Une modernisation réglementaire est également attendue, notamment en ce qui concerne la transparence des risques liés à ces titres, et les obligations de reporting pour les émetteurs.
Et si cette hausse des émissions de dette privée n’était qu’un reflet des faiblesses du crédit bancaire ? Plutôt qu’un signe de vitalité, on pourrait y voir une forme de contournement opportuniste par les grandes institutions, qui disposent de moyens pour lever des fonds à bas coût sur des marchés peu concurrentiels.
Le paradoxe est cruel : alors que l’économie marocaine peine à financer ses PME, le marché de la dette privée reste captif des mêmes acteurs puissants, dans une logique d’optimisation financière bien plus que d’investissement productif. Sans un rééquilibrage volontaire, cette dette privée ne servira pas à réindustrialiser le Maroc… mais à accroître l’effet levier d’un système financier déjà surconcentré.
Des banques omniprésentes
Le secteur financier continue de dominer outrageusement les levées de dette : les banques et organismes financiers représentent 70 % des montants levés. Ce sont eux qui ont le plus souvent recours aux obligations subordonnées, aux TCN ou aux placements privés pour optimiser leur structure de capital ou financer leur croissance.
À l’inverse, la part des entreprises industrielles, commerciales ou technologiques dans ces opérations reste marginale. L’usage du marché obligataire demeure une affaire d’initiés, souvent réservé aux grands groupes structurés, avec notation de crédit et relations solides avec les investisseurs.
Des instruments techniques, peu accessibles au grand public
La montée en puissance de produits comme les obligations perpétuelles ou les TCN à court terme illustre la sophistication croissante du marché. Mais cette complexité éloigne les PME ou les collectivités locales, qui pourraient pourtant bénéficier de ce mode de financement désintermédié.
De plus, ces instruments sont rarement ouverts à l’épargne des particuliers, ce qui accentue la déconnexion entre les besoins de financement de l’économie réelle et les circuits disponibles pour l’investissement citoyen.
Vers une meilleure structuration ?
Pour rendre le marché plus inclusif, certains appellent à :
Créer des fonds spécialisés dans la dette privée des PME, garantis partiellement par l’État.
Simplifier l’émission de mini-obligations ou de TCN dédiés aux collectivités.
Améliorer la lisibilité des offres de dette pour les non-initiés, y compris via la cotation.
Une modernisation réglementaire est également attendue, notamment en ce qui concerne la transparence des risques liés à ces titres, et les obligations de reporting pour les émetteurs.
Et si cette hausse des émissions de dette privée n’était qu’un reflet des faiblesses du crédit bancaire ? Plutôt qu’un signe de vitalité, on pourrait y voir une forme de contournement opportuniste par les grandes institutions, qui disposent de moyens pour lever des fonds à bas coût sur des marchés peu concurrentiels.
Le paradoxe est cruel : alors que l’économie marocaine peine à financer ses PME, le marché de la dette privée reste captif des mêmes acteurs puissants, dans une logique d’optimisation financière bien plus que d’investissement productif. Sans un rééquilibrage volontaire, cette dette privée ne servira pas à réindustrialiser le Maroc… mais à accroître l’effet levier d’un système financier déjà surconcentré.
Autres articles
-
 Maroc : nouveau pilier économique dans la lutte régionale contre les flux financiers illicites
Maroc : nouveau pilier économique dans la lutte régionale contre les flux financiers illicites
-
 OCP obtient 450 M€ de garantie de la BAD pour financer sa transition verte
OCP obtient 450 M€ de garantie de la BAD pour financer sa transition verte
-
 Bourse de Casablanca : 246,4 MMDH de revenus à fin septembre 2025
Bourse de Casablanca : 246,4 MMDH de revenus à fin septembre 2025
-
 Saham Bank : une première notation Moody’s Ratings Ba1
Saham Bank : une première notation Moody’s Ratings Ba1
-
 RCI Finance Maroc mobilise 900 MDH via une émission obligataire stratégique pour le financement automobile
RCI Finance Maroc mobilise 900 MDH via une émission obligataire stratégique pour le financement automobile
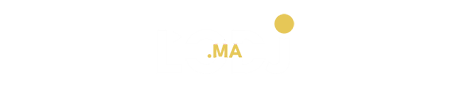











 L'accueil
L'accueil
















