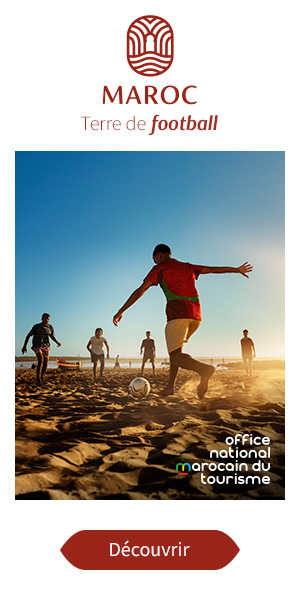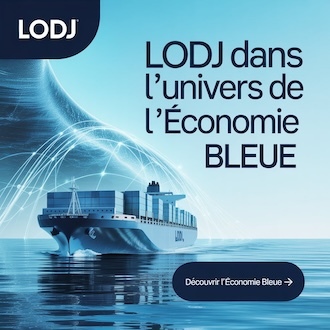Une nouvelle ère pour l’enseignement collégial : Le collège, un cycle critique et sous tension
Le Maroc franchit un cap décisif dans sa réforme éducative. Après le succès mesuré des « écoles pionnières » dans le primaire, c’est désormais le tour des collèges d’entrer dans la danse. L’annonce a été faite par le Chef du gouvernement Aziz Akhannouch devant les députés : une première vague de « collèges pionniers » a vu le jour, portée par une ambition claire – changer en profondeur le visage de l’enseignement public au niveau du cycle collégial, souvent considéré comme le maillon faible du système éducatif national.
Le collège, cette étape charnière entre l’enfance et l’adolescence, reste le théâtre de grandes difficultés : perte de repères, manque d’encadrement personnalisé, décrochage rampant… Le taux de déperdition scolaire y atteint des sommets inquiétants. C’est là que le gouvernement a décidé d’intervenir, fort de l’expérience tirée des écoles pionnières qui ont amorcé, dans le primaire, une dynamique de qualité pédagogique nouvelle.
Ce sont donc environ 230 collèges – soit 10 % du total national – qui expérimentent ce modèle rénové depuis la rentrée. Près de 200 000 élèves sont concernés, encadrés par plus de 6000 enseignants et 600 inspecteurs pédagogiques. Une mobilisation inédite à cette échelle, saluée comme un signal fort en faveur de la justice éducative.
Le collège, cette étape charnière entre l’enfance et l’adolescence, reste le théâtre de grandes difficultés : perte de repères, manque d’encadrement personnalisé, décrochage rampant… Le taux de déperdition scolaire y atteint des sommets inquiétants. C’est là que le gouvernement a décidé d’intervenir, fort de l’expérience tirée des écoles pionnières qui ont amorcé, dans le primaire, une dynamique de qualité pédagogique nouvelle.
Ce sont donc environ 230 collèges – soit 10 % du total national – qui expérimentent ce modèle rénové depuis la rentrée. Près de 200 000 élèves sont concernés, encadrés par plus de 6000 enseignants et 600 inspecteurs pédagogiques. Une mobilisation inédite à cette échelle, saluée comme un signal fort en faveur de la justice éducative.
Un projet structuré autour de quatre axes
Cette réforme ne s’improvise pas. Elle repose sur quatre piliers complémentaires, chacun pensé pour répondre aux failles du système :
1. Le pilotage et la structuration des établissements
L’approche consiste à redéfinir le projet pédagogique de chaque collège. Pour cela, des moyens humains sont mis à disposition : cadres administratifs qualifiés, équipes pédagogiques renforcées, mais aussi un environnement plus accueillant grâce à l’introduction du numérique dans les salles de classe. Ce n’est pas seulement une amélioration logistique : c’est une refonte de l’espace éducatif pour en faire un levier de motivation.
2. L’éveil des compétences personnelles
Le gouvernement mise sur l’approche TARL (Teaching At the Right Level), axée sur le soutien individualisé. L’objectif est clair : faire progresser chaque élève selon son niveau réel, et non selon son âge ou sa classe. Des séances de coaching en soft-skills, des cellules de veille pour détecter les risques de décrochage, des activités sportives et culturelles… tout est fait pour (re)donner confiance aux collégiens.
3. Le soutien aux enseignants
Le projet ne pouvait aboutir sans repenser l’accompagnement des professeurs. Formations continues, outils pédagogiques innovants, pratiques d’enseignement collaboratif… Les enseignants des collèges pionniers ne sont plus de simples exécutants : ils deviennent des moteurs de transformation.
4. Le cadre de vie scolaire
De nouvelles infrastructures voient le jour : classes réaménagées, salles équipées de matériel numérique, espaces sportifs rénovés, et zones dédiées aux ateliers artistiques, scientifiques ou entrepreneuriaux. Au-delà de l’esthétique, c’est une volonté de revaloriser l’école publique aux yeux des élèves, des parents et des enseignants.
1. Le pilotage et la structuration des établissements
L’approche consiste à redéfinir le projet pédagogique de chaque collège. Pour cela, des moyens humains sont mis à disposition : cadres administratifs qualifiés, équipes pédagogiques renforcées, mais aussi un environnement plus accueillant grâce à l’introduction du numérique dans les salles de classe. Ce n’est pas seulement une amélioration logistique : c’est une refonte de l’espace éducatif pour en faire un levier de motivation.
2. L’éveil des compétences personnelles
Le gouvernement mise sur l’approche TARL (Teaching At the Right Level), axée sur le soutien individualisé. L’objectif est clair : faire progresser chaque élève selon son niveau réel, et non selon son âge ou sa classe. Des séances de coaching en soft-skills, des cellules de veille pour détecter les risques de décrochage, des activités sportives et culturelles… tout est fait pour (re)donner confiance aux collégiens.
3. Le soutien aux enseignants
Le projet ne pouvait aboutir sans repenser l’accompagnement des professeurs. Formations continues, outils pédagogiques innovants, pratiques d’enseignement collaboratif… Les enseignants des collèges pionniers ne sont plus de simples exécutants : ils deviennent des moteurs de transformation.
4. Le cadre de vie scolaire
De nouvelles infrastructures voient le jour : classes réaménagées, salles équipées de matériel numérique, espaces sportifs rénovés, et zones dédiées aux ateliers artistiques, scientifiques ou entrepreneuriaux. Au-delà de l’esthétique, c’est une volonté de revaloriser l’école publique aux yeux des élèves, des parents et des enseignants.
Des moyens financiers renforcés pour des ambitions assumées
Cette réforme ne se contente pas de discours. Chaque collège pionnier bénéficie d’une enveloppe minimale annuelle de 200 000 dirhams, allouée à l’amélioration de son projet pédagogique. Le coût d’investissement initial avoisine les 30 000 dirhams par classe au collège (25 000 au primaire), auquel s’ajoute une dépense de fonctionnement annuelle de 12 500 dirhams. Ces montants, bien que modestes au regard des budgets internationaux, traduisent un effort inédit dans le contexte budgétaire marocain.
Former pour prévenir : des cellules de veille sociale et psychologique
Parce que l’adolescence est aussi un âge de turbulences psychologiques, le gouvernement a mis l’accent sur l’accompagnement social. Plus de 80 assistants sociaux ont été formés pour intégrer les « cellules de veille » dans les collèges.
Leur rôle : écouter, orienter, alerter. Ils seront les sentinelles d’un climat scolaire apaisé et inclusif, un facteur clé pour enrayer les comportements déviants ou violents.
Leur rôle : écouter, orienter, alerter. Ils seront les sentinelles d’un climat scolaire apaisé et inclusif, un facteur clé pour enrayer les comportements déviants ou violents.
Une école juste, pas une école d’élite
Akhannouch a insisté sur ce point : ces établissements pionniers ne sont pas des écoles à part pour quelques élus. Ils sont conçus comme des laboratoires de transformation, voués à essaimer leurs bonnes pratiques dans tout le système public. L’ambition n’est donc pas de créer un entre-soi élitiste, mais de construire une école équitable, innovante, capable de retenir tous les enfants, y compris ceux en risque de décrochage.
C’est dans ce sens qu’il a rappelé l’adoption de la loi 59-21 sur l’enseignement scolaire comme un jalon structurant du processus de réforme. Une loi qui donne un cadre légal à la feuille de route 2022-2026 pour une école nouvelle, plus ouverte, plus efficace, plus humaine.
Vers une génération réconciliée avec l’école
À terme, le gouvernement veut créer un effet d’entraînement. En redonnant du sens à l’enseignement au collège, il espère enrayer le phénomène des NEET – ces jeunes ni en emploi, ni en formation, ni en étude – qui gangrène la société marocaine. L’école n’est plus seulement un lieu d’instruction, mais un espace de réinvention de soi. Théâtre, musique, arts visuels, projets citoyens… L’école pionnière devient une fabrique d’individus épanouis, prêts à affronter le monde.
C’est dans ce sens qu’il a rappelé l’adoption de la loi 59-21 sur l’enseignement scolaire comme un jalon structurant du processus de réforme. Une loi qui donne un cadre légal à la feuille de route 2022-2026 pour une école nouvelle, plus ouverte, plus efficace, plus humaine.
Vers une génération réconciliée avec l’école
À terme, le gouvernement veut créer un effet d’entraînement. En redonnant du sens à l’enseignement au collège, il espère enrayer le phénomène des NEET – ces jeunes ni en emploi, ni en formation, ni en étude – qui gangrène la société marocaine. L’école n’est plus seulement un lieu d’instruction, mais un espace de réinvention de soi. Théâtre, musique, arts visuels, projets citoyens… L’école pionnière devient une fabrique d’individus épanouis, prêts à affronter le monde.
Le pari est audacieux, et les défis restent nombreux : hétérogénéité des territoires, pénurie de cadres formés, inertie administrative… Mais le fait que l’État investisse dans cette tranche critique du système éducatif est en soi un signal porteur d’espoir. Pour une fois, on ne se contente pas de réagir aux échecs : on anticipe, on construit. Et cela, dans l’univers souvent figé de l’éducation, mérite d’être salué.












 L'accueil
L'accueil