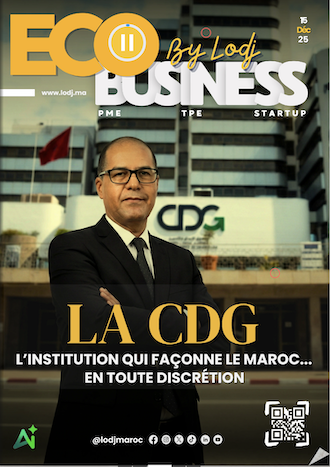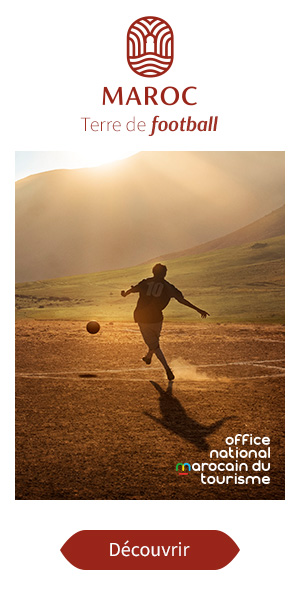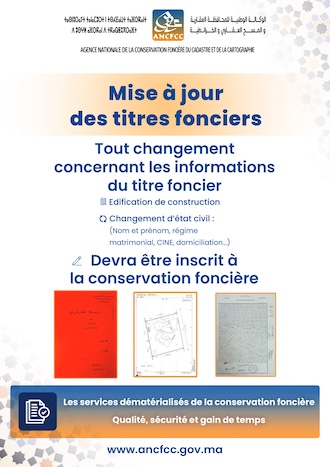Entretien avec Sophia El Khensae Bentamy
Q1. Madame Bentamy, vous parlez d’un type de collaborateur qui, en apparence, est un pilier de l’équipe, mais qui, en réalité, désorganise l’entreprise de l’intérieur. Qu’est-ce qui vous a poussée à alerter sur ce profil ?
Madame Bentamy : Aujourd’hui, dans de nombreuses organisations, on confond visibilité et efficacité. Ce que j’observe comme consultante et coach, c’est qu’un certain type de collaborateur, très présent auprès de la hiérarchie, finit par imposer une vision biaisée du travail. Il donne l’impression de porter à bout de bras l’entreprise. Il gère les urgences, connaît tous les rouages, est toujours “disponible” et “proactif”… Mais ce vernis cache souvent un fonctionnement désastreux en coulisses. Ce type de profil centralise l’information, étouffe les synergies, décourage les talents émergents. Et ce qui m’a poussée à écrire, c’est l’invisibilité de ce phénomène. On admire ces profils parce qu’ils donnent l’impression d’être indispensables, alors qu’ils créent une véritable dépendance toxique. Ce sont des “collabos” au sens propre : ils collaborent avec le boss… mais rarement avec l’équipe. Il fallait que cette dynamique soit rendue visible, pour libérer la parole de ceux qui, dans l’ombre, subissent.
Q2. Vous évoquez une “stratégie du faux zélé”. Pouvez-vous détailler ce que cela signifie concrètement dans le quotidien d’une entreprise ?
Madame Bentamy : La “stratégie du faux zélé”, c’est l’art de paraître utile sans vraiment l’être à long terme. Ces collaborateurs prennent soin de se rendre visibles au bon moment, devant les bonnes personnes, souvent les décideurs. Ils vont s’approprier les idées des autres, les reformuler à leur avantage, et les présenter comme les leurs. Ce sont des maîtres de la communication verticale, c’est-à-dire vers le haut, mais très médiocres dans la communication horizontale, avec leurs collègues. Dans les faits, ils délèguent énormément mais gardent le mérite. Ils se positionnent comme les sauveurs de dernière minute, créant parfois eux-mêmes les problèmes qu’ils viennent ensuite “résoudre”. Leur présence donne l’illusion d’un fonctionnement efficace, mais c’est une façade. En réalité, ils freinent la fluidité, bloquent la coopération, et instaurent une culture de la peur, où les autres hésitent à s’exprimer ou à proposer. C’est une stratégie de domination douce, qui use les équipes dans le silence.
Q3. Comment un manager peut-il tomber dans le piège de ces collaborateurs “modèles” sans s’en rendre compte ?
Madame Bentamy : C’est une excellente question, et malheureusement, c’est un piège très courant. Un manager débordé, sous pression, va naturellement se reposer sur celui qui semble le plus “réactif”. Il voit une personne qui prend des initiatives, règle des problèmes, connaît tout le monde… et se dit que c’est un atout précieux. Ce qu’il ne voit pas, c’est l’effet domino. Il ne prend pas toujours le temps d’observer les autres membres de l’équipe. Il n’écoute pas ceux qui s’éteignent, qui n’osent plus parler. Il félicite le résultat sans comprendre le processus. Et surtout, il oublie que l’efficacité d’une équipe ne repose pas sur un seul individu. Le problème, c’est qu’à force de déléguer sans encadrer, il devient complice d’un déséquilibre. Il valorise celui qui parle fort, au détriment de ceux qui travaillent en silence. C’est ce que j’appelle le “management à l’aveugle”. Pour éviter cela, il faut cultiver une présence terrain et une vraie écoute des dynamiques collectives.
Q4. Dans votre texte, vous soulignez les dégâts humains de cette situation. Pouvez-vous nous en dire plus sur ces “ruines invisibles” que vous évoquez ?
Madame Bentamy : Oui, et c’est un point crucial. Derrière l’apparente efficacité d’un collaborateur hypervisible, il y a souvent des équipes fatiguées, démotivées, voire traumatisées. Les collègues de ces “faux piliers” finissent par se taire ou partir. Pourquoi ? Parce qu’ils se sentent trahis. Ils voient leurs efforts minimisés, leurs idées détournées, leur engagement ignoré. Le climat de travail devient malsain : méfiance, compétition, peur de se faire “piquer” ses réussites. Cela mène à une baisse d’implication, une fuite des talents, et une rupture dans la confiance collective. Les jeunes recrues, les stagiaires, les profils autonomes ne restent pas. Et au final, ce sont les meilleurs qui partent. L’usurpateur reste, car il sait jouer avec les apparences. Mais l’entreprise s’affaiblit lentement. Ces dégâts ne sont pas mesurés dans les tableaux de bord classiques, mais ils sont bien réels : turnover élevé, innovation en berne, conflits latents… Et parfois même des burn-out dissimulés.
Q5. Vous évoquez la “tour d’ivoire” dans laquelle certains dirigeants se retranchent. Quel est, selon vous, le rôle d’un vrai leader face à ces dynamiques toxiques ?
Madame Bentamy : Un vrai leader, c’est quelqu’un qui descend de sa tour d’ivoire, qui observe les signaux faibles, qui écoute les silences. Il ne se contente pas des comptes-rendus ou des résultats ponctuels. Il va sur le terrain, parle aux équipes, cherche à comprendre les dynamiques réelles, pas celles que l’on veut bien lui montrer. Il valorise le travail collectif, les processus, pas seulement les livrables. Un bon leader sait que la performance durable repose sur la cohésion, la transparence et le respect mutuel. Face à un collaborateur “modèle” qui centralise et manipule, il ne se laisse pas aveugler. Il pose des questions, demande des feedbacks à tous les niveaux, croise les sources. Il met en place des systèmes qui favorisent la responsabilité partagée, pas la starification individuelle. Et surtout, il protège ses équipes de ces profils prédateurs qui, sous couvert de loyauté, sapent les fondements mêmes de l’organisation.
Q6. Quelles sont les premières actions concrètes qu’une entreprise peut mettre en place pour sortir de ce piège ?
Madame Bentamy : La première action, c’est d’instaurer une culture du feedback honnête, transversal et sécurisé. Il faut créer des espaces où chacun peut s’exprimer sans peur de représailles. Ensuite, il faut analyser les dynamiques : qui participe ? Qui est écouté ? Qui se tait ? Il est important de croiser les données qualitatives (climat d’équipe, ressenti) et quantitatives (taux de rotation, satisfaction client, retards…). Un audit managérial, même simple, peut faire émerger des réalités invisibles. Deuxième point : revoir les critères de reconnaissance. Cessez de valoriser uniquement les “héros” visibles et récompensez ceux qui contribuent réellement à la solidité collective. Troisième levier : former les managers à repérer les jeux de pouvoir, les faux zélés, les destructeurs d’équipe camouflés. Enfin, inclure des indicateurs de bien-être et de coopération dans les évaluations de performance est une piste essentielle. Ce n’est pas une question de gentillesse, mais de performance durable.
Q7. Comment reconnaître un vrai “pilier” d’équipe d’un “boulet” déguisé en collaborateur modèle ? Quels sont les signaux faibles ?
Madame Bentamy : Le vrai pilier, c’est celui qui fédère, partage, soutient. Il ne brille pas toujours, mais il fait briller les autres. Il a une mémoire collective, il transmet, il aide à intégrer les nouveaux. Il assume ses erreurs, reconnaît celles des autres, et valorise les réussites collectives. À l’inverse, le “boulet” déguisé adore les projecteurs. Il parle de lui, minimise les autres, esquive les responsabilités et se positionne toujours en “sauveur”. Il n’a que peu de traces écrites, peu de processus partagés. Il évite les outils collaboratifs, préfère les échanges informels où il peut manipuler. Le signal faible le plus courant ? Le silence autour de lui. Une équipe qui s’éteint, une rotation excessive, une innovation à l’arrêt. Et surtout… des talents qui partent sans bruit. Un bon manager doit apprendre à lire ces silences.
Q8. Qu’aimeriez-vous dire aux entreprises qui se reconnaissent dans ce que vous décrivez ?
Madame Bentamy : Je veux leur dire que voir le problème, c’est déjà le début de la solution. Aucune organisation n’est à l’abri de ce type de dérive. C’est humain. On veut croire à la personne qui “fait tout”, surtout quand on est sous tension. Mais il faut avoir le courage de réinterroger les évidences. Ce que je propose, ce n’est pas une chasse aux sorcières. C’est un retour à l’intelligence collective, à l’humilité managériale. Il faut remettre à plat les logiques de pouvoir, les canaux de reconnaissance, et ouvrir les yeux sur les conséquences humaines de certaines dynamiques. C’est exigeant, mais c’est salvateur. Car une entreprise qui fonctionne sur l’authenticité, la collaboration et la transparence est non seulement plus saine, mais aussi plus performante. Il n’est jamais trop tard pour écouter, réajuster, et faire émerger les vrais leaders : ceux qui travaillent pour les autres, pas pour leur ego.
Madame Bentamy : Aujourd’hui, dans de nombreuses organisations, on confond visibilité et efficacité. Ce que j’observe comme consultante et coach, c’est qu’un certain type de collaborateur, très présent auprès de la hiérarchie, finit par imposer une vision biaisée du travail. Il donne l’impression de porter à bout de bras l’entreprise. Il gère les urgences, connaît tous les rouages, est toujours “disponible” et “proactif”… Mais ce vernis cache souvent un fonctionnement désastreux en coulisses. Ce type de profil centralise l’information, étouffe les synergies, décourage les talents émergents. Et ce qui m’a poussée à écrire, c’est l’invisibilité de ce phénomène. On admire ces profils parce qu’ils donnent l’impression d’être indispensables, alors qu’ils créent une véritable dépendance toxique. Ce sont des “collabos” au sens propre : ils collaborent avec le boss… mais rarement avec l’équipe. Il fallait que cette dynamique soit rendue visible, pour libérer la parole de ceux qui, dans l’ombre, subissent.
Q2. Vous évoquez une “stratégie du faux zélé”. Pouvez-vous détailler ce que cela signifie concrètement dans le quotidien d’une entreprise ?
Madame Bentamy : La “stratégie du faux zélé”, c’est l’art de paraître utile sans vraiment l’être à long terme. Ces collaborateurs prennent soin de se rendre visibles au bon moment, devant les bonnes personnes, souvent les décideurs. Ils vont s’approprier les idées des autres, les reformuler à leur avantage, et les présenter comme les leurs. Ce sont des maîtres de la communication verticale, c’est-à-dire vers le haut, mais très médiocres dans la communication horizontale, avec leurs collègues. Dans les faits, ils délèguent énormément mais gardent le mérite. Ils se positionnent comme les sauveurs de dernière minute, créant parfois eux-mêmes les problèmes qu’ils viennent ensuite “résoudre”. Leur présence donne l’illusion d’un fonctionnement efficace, mais c’est une façade. En réalité, ils freinent la fluidité, bloquent la coopération, et instaurent une culture de la peur, où les autres hésitent à s’exprimer ou à proposer. C’est une stratégie de domination douce, qui use les équipes dans le silence.
Q3. Comment un manager peut-il tomber dans le piège de ces collaborateurs “modèles” sans s’en rendre compte ?
Madame Bentamy : C’est une excellente question, et malheureusement, c’est un piège très courant. Un manager débordé, sous pression, va naturellement se reposer sur celui qui semble le plus “réactif”. Il voit une personne qui prend des initiatives, règle des problèmes, connaît tout le monde… et se dit que c’est un atout précieux. Ce qu’il ne voit pas, c’est l’effet domino. Il ne prend pas toujours le temps d’observer les autres membres de l’équipe. Il n’écoute pas ceux qui s’éteignent, qui n’osent plus parler. Il félicite le résultat sans comprendre le processus. Et surtout, il oublie que l’efficacité d’une équipe ne repose pas sur un seul individu. Le problème, c’est qu’à force de déléguer sans encadrer, il devient complice d’un déséquilibre. Il valorise celui qui parle fort, au détriment de ceux qui travaillent en silence. C’est ce que j’appelle le “management à l’aveugle”. Pour éviter cela, il faut cultiver une présence terrain et une vraie écoute des dynamiques collectives.
Q4. Dans votre texte, vous soulignez les dégâts humains de cette situation. Pouvez-vous nous en dire plus sur ces “ruines invisibles” que vous évoquez ?
Madame Bentamy : Oui, et c’est un point crucial. Derrière l’apparente efficacité d’un collaborateur hypervisible, il y a souvent des équipes fatiguées, démotivées, voire traumatisées. Les collègues de ces “faux piliers” finissent par se taire ou partir. Pourquoi ? Parce qu’ils se sentent trahis. Ils voient leurs efforts minimisés, leurs idées détournées, leur engagement ignoré. Le climat de travail devient malsain : méfiance, compétition, peur de se faire “piquer” ses réussites. Cela mène à une baisse d’implication, une fuite des talents, et une rupture dans la confiance collective. Les jeunes recrues, les stagiaires, les profils autonomes ne restent pas. Et au final, ce sont les meilleurs qui partent. L’usurpateur reste, car il sait jouer avec les apparences. Mais l’entreprise s’affaiblit lentement. Ces dégâts ne sont pas mesurés dans les tableaux de bord classiques, mais ils sont bien réels : turnover élevé, innovation en berne, conflits latents… Et parfois même des burn-out dissimulés.
Q5. Vous évoquez la “tour d’ivoire” dans laquelle certains dirigeants se retranchent. Quel est, selon vous, le rôle d’un vrai leader face à ces dynamiques toxiques ?
Madame Bentamy : Un vrai leader, c’est quelqu’un qui descend de sa tour d’ivoire, qui observe les signaux faibles, qui écoute les silences. Il ne se contente pas des comptes-rendus ou des résultats ponctuels. Il va sur le terrain, parle aux équipes, cherche à comprendre les dynamiques réelles, pas celles que l’on veut bien lui montrer. Il valorise le travail collectif, les processus, pas seulement les livrables. Un bon leader sait que la performance durable repose sur la cohésion, la transparence et le respect mutuel. Face à un collaborateur “modèle” qui centralise et manipule, il ne se laisse pas aveugler. Il pose des questions, demande des feedbacks à tous les niveaux, croise les sources. Il met en place des systèmes qui favorisent la responsabilité partagée, pas la starification individuelle. Et surtout, il protège ses équipes de ces profils prédateurs qui, sous couvert de loyauté, sapent les fondements mêmes de l’organisation.
Q6. Quelles sont les premières actions concrètes qu’une entreprise peut mettre en place pour sortir de ce piège ?
Madame Bentamy : La première action, c’est d’instaurer une culture du feedback honnête, transversal et sécurisé. Il faut créer des espaces où chacun peut s’exprimer sans peur de représailles. Ensuite, il faut analyser les dynamiques : qui participe ? Qui est écouté ? Qui se tait ? Il est important de croiser les données qualitatives (climat d’équipe, ressenti) et quantitatives (taux de rotation, satisfaction client, retards…). Un audit managérial, même simple, peut faire émerger des réalités invisibles. Deuxième point : revoir les critères de reconnaissance. Cessez de valoriser uniquement les “héros” visibles et récompensez ceux qui contribuent réellement à la solidité collective. Troisième levier : former les managers à repérer les jeux de pouvoir, les faux zélés, les destructeurs d’équipe camouflés. Enfin, inclure des indicateurs de bien-être et de coopération dans les évaluations de performance est une piste essentielle. Ce n’est pas une question de gentillesse, mais de performance durable.
Q7. Comment reconnaître un vrai “pilier” d’équipe d’un “boulet” déguisé en collaborateur modèle ? Quels sont les signaux faibles ?
Madame Bentamy : Le vrai pilier, c’est celui qui fédère, partage, soutient. Il ne brille pas toujours, mais il fait briller les autres. Il a une mémoire collective, il transmet, il aide à intégrer les nouveaux. Il assume ses erreurs, reconnaît celles des autres, et valorise les réussites collectives. À l’inverse, le “boulet” déguisé adore les projecteurs. Il parle de lui, minimise les autres, esquive les responsabilités et se positionne toujours en “sauveur”. Il n’a que peu de traces écrites, peu de processus partagés. Il évite les outils collaboratifs, préfère les échanges informels où il peut manipuler. Le signal faible le plus courant ? Le silence autour de lui. Une équipe qui s’éteint, une rotation excessive, une innovation à l’arrêt. Et surtout… des talents qui partent sans bruit. Un bon manager doit apprendre à lire ces silences.
Q8. Qu’aimeriez-vous dire aux entreprises qui se reconnaissent dans ce que vous décrivez ?
Madame Bentamy : Je veux leur dire que voir le problème, c’est déjà le début de la solution. Aucune organisation n’est à l’abri de ce type de dérive. C’est humain. On veut croire à la personne qui “fait tout”, surtout quand on est sous tension. Mais il faut avoir le courage de réinterroger les évidences. Ce que je propose, ce n’est pas une chasse aux sorcières. C’est un retour à l’intelligence collective, à l’humilité managériale. Il faut remettre à plat les logiques de pouvoir, les canaux de reconnaissance, et ouvrir les yeux sur les conséquences humaines de certaines dynamiques. C’est exigeant, mais c’est salvateur. Car une entreprise qui fonctionne sur l’authenticité, la collaboration et la transparence est non seulement plus saine, mais aussi plus performante. Il n’est jamais trop tard pour écouter, réajuster, et faire émerger les vrais leaders : ceux qui travaillent pour les autres, pas pour leur ego.












 L'accueil
L'accueil