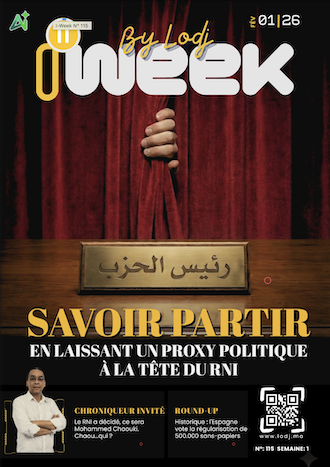Promesse flamboyante, réalité plus têtue : l’ère des « vaccins contre le cancer » n’est pas un slogan marketing, c’est une trajectoire scientifique qui s’éclaircit.
Des deux côtés de l’Atlantique, les équipes progressent vite sur une idée simple et redoutable : entraîner le système immunitaire de chaque patient à reconnaître les mutations uniques de sa tumeur, puis renforcer cette réponse par l’immunothérapie.
Les résultats sont encore parcellaires, mais ils se répètent, se durcissent statistiquement, et commencent à franchir la frontière des essais précoces vers des études de phase avancée.
De là à annoncer « la fin du cancer », non. Dire que certains cancers, à certains stades, chez certains patients, sont en train de basculer vers des pronostics durablement meilleurs : oui.
Aux États-Unis, le tandem Moderna–Merck a posé la borne la plus visible. Leur vaccin individualisé V940 (mRNA-4157), administré après chirurgie du mélanome et en combinaison avec l’anti-PD-1 Keytruda, a montré en phase 2b une réduction importante du risque de récidive ou de décès, avec un bénéfice durable jusqu’à près de trois ans de suivi. Les entreprises ont lancé plusieurs phases 3 : mélanome réséqué (INTerpath-001) et cancer du poumon non à petites cellules (INTerpath-002), ainsi que des phases 2 dans rein, urothélial et carcinome épidermoïde cutané. Les endpoints portent sur la survie sans maladie et la survie globale, bref les critères qui comptent pour les patients.
Dans le pancréas, terrain quasi désespéré, le pari de la personnalisation commence aussi à percer. Le vaccin autogene cevumeran (BioNTech/Roche) a suscité des réponses T spécifiques chez environ la moitié des patients, avec des signes de protection prolongée chez certains malades suivis plus de trois ans ; un essai de phase suivante est en cours. On est encore loin d’un standard, mais l’immunogénicité robuste et la tolérance répliquées dans différents rapports scientifiques valident la voie.
Autre filon américain : la prévention ciblée. Cleveland Clinic et Anixa testent un vaccin dirigé contre l’alpha-lactalbumine, protéine normalement exprimée pendant l’allaitement mais anormalement ré-exprimée dans des cancers du sein agressifs. La phase 1 finalisée indique sécurité et réponses immunes substantielles ; des discussions FDA pour phase 2 sont sur la table. Ici, l’ambition est double : retarder les récidives et, chez des populations sélectionnées, prévenir certains sous-types. Prudence méthodologique : on parle d’essai précoce, non randomisé, mais l’hypothèse biologique est solide.
Côté français, l’écosystème avance avec moins de bruit, mais des signaux sérieux. Transgene (plateforme myvac) développe TG4050, vaccin ultra-personnalisé sélectionnant des néo-antigènes via l’IA de NEC et les encodant dans un vecteur viral. En tête-cou HPV-négatif et ovaire, la phase 1 montre réponses T durables et, en adjuvant, des cohortes sans rechute sur deux ans dans le bras vacciné d’un randomisé de phase I/II, résultat spectaculaire qu’il faudra confirmer en partie II et au-delà. L’entreprise annonce la fin de randomisation de la phase II d’ici fin 2025 : la bascule vers la preuve clinique « dure » se jouera là.
Dans une approche moins custom et plus « prête à l’emploi », OSE Immunotherapeutics avance Tedopi, vaccin peptidique multi-épitopes destiné aux patients HLA-A2. Après des données encourageantes antérieures, l’essai ARTEMIA en phase 3 dans le cancer du poumon non à petites cellules (en 2ᵉ ligne, résistance secondaire aux inhibiteurs de points de contrôle) est en cours et potentiellement enregistrement si positif. Le design compare Tedopi à docétaxel avec survie comme juge. C’est un test industriel majeur pour une immunothérapie « vaccinale » non mRNA et non personnalisée.
Que faut-il retenir ? D’abord, que « vaccin contre le cancer » ne veut presque jamais dire préventif universel comme la rougeole. On parle surtout de vaccins thérapeutiques donnés après chirurgie (adjuvant) ou avant (néoadjuvant), souvent combinés à un anti-PD-1/PD-L1.
L’idée n’est pas d’empêcher tout cancer, mais de reprogrammer l’immunité pour qu’elle traque les cellules résiduelles et empêche la rechute ou la dissémination. Cette stratégie est scientifiquement cohérente : les néo-antigènes tumoraux sont propres à chaque patient, donc immunogènes, mais changeants ; d’où la personnalisation côté mRNA/IA (V940, autogene cevumeran, TG4050), ou la recherche d’épitopes partagés (Tedopi).
Ensuite, que le mur clinique arrive maintenant : la phase 3. Les effets magnifiques des petites cohortes s’y cassent parfois les dents. Les équipes de Moderna/Merck jouent franc-jeu : endpoints exigeants, populations à haut risque, concurrence d’un standard immuno déjà très efficace (Keytruda). Si la DFS (survie sans maladie) se confirme et que l’OS (survie globale) suit, V940+Keytruda pourrait devenir un standard en mélanome réséqué, puis essaimer vers le poumon. S’il échoue, la stratégie restera niche ou indication-dépendante. C’est l’année des preuves.
Troisième leçon : la logistique sera un juge de paix. Les vaccins sur-mesure exigent séquençage tumoral, bio-informatique, chaînes de production rapides. Or le cancer n’attend pas. Les industriels affûtent les cycles ; certains centres annoncent déjà des délais compatibles avec une fenêtre adjuvante post-opératoire (quelques semaines). Mais la généralisation hors hubs de pointe demandera plateformes régionales, remboursements et une standardisation des flux qu’aucun communiqué de presse ne résout.
Enfin, il faut parler de mesure. Oui, les courbes s’améliorent. Oui, des patients autrefois voués à la récidive restent sans maladie plus longtemps. Mais aucun de ces programmes n’autorise le raccourci « fin du cancer ». Le pluriel s’impose : les cancers. Biologies hétérogènes, micro-environnements immunitaires capricieux, échappements multiples. Le vaccin ne sera ni baguette magique ni gadget ; il s’ajoute à la chirurgie, à la radiothérapie, aux thérapies ciblées, à l’immuno, pour faire basculer le pronostic d’un sous-ensemble croissant de patients. Et c’est déjà énorme.
Comparons, pour finir, avec les annonces tonitruantes venues d’ailleurs. Affirmer des efficacités « à 100 % » en préclinique, ou promettre l’« usage clinique » avant toute phase humaine solide, n’a aucune valeur au standard international. La science n’interdit pas l’optimisme, elle l’ordonne : d’abord publier, ensuite reproduire, puis généraliser. Ce qui crédibilise aujourd’hui les pistes américaine et française, c’est précisément la publication dans des revues à comité de lecture, le lancement d’essais randomisés et le choix d’endpoints durs. Là se joue la différence entre promesse et preuve.
Alors, « le cancer, c’est bientôt la fin » ? Non, et ce n’est pas grave : la fin de certains scénarios du cancer, oui. Le mélanome à haut risque pourrait devenir, demain, moins récidivant. Des niches réputées intraitables (pancréas) laissent entrevoir des répondeurs durables. Des approches hybrides (prévention ciblée du sein, vaccins standardisables comme Tedopi) pourraient élargir l’accès. La révolution est moins un feu d’artifice qu’un travail d’orfèvre : mutation par mutation, patient par patient, coupe après coupe, la médecine façonne un nouvel équilibre avec la maladie. L’espoir n’est pas un hashtag ; c’est une méthode qui, ligne après ligne de protocole, déplace la frontière.
À surveiller, très concrètement, dans les prochains mois : les lectures intermédiaires des phases 3 V940+Keytruda (mélanome, puis poumon) ; la mise en phase 2 du vaccin alpha-lactalbumine à Cleveland ; la lecture d’ARTEMIA pour Tedopi ; et la poursuite des essais BioNTech/Roche au pancréas, avec des critères cliniques irréprochables. Si deux ou trois de ces dominos tombent dans le bon sens, l’expression « vaccin contre le cancer » cessera d’être une formule polémique pour devenir un outil clinique à part entière. Et là, sans fracas, certains cancers vivront leurs derniers beaux jours.
Les résultats sont encore parcellaires, mais ils se répètent, se durcissent statistiquement, et commencent à franchir la frontière des essais précoces vers des études de phase avancée.
De là à annoncer « la fin du cancer », non. Dire que certains cancers, à certains stades, chez certains patients, sont en train de basculer vers des pronostics durablement meilleurs : oui.
Aux États-Unis, le tandem Moderna–Merck a posé la borne la plus visible. Leur vaccin individualisé V940 (mRNA-4157), administré après chirurgie du mélanome et en combinaison avec l’anti-PD-1 Keytruda, a montré en phase 2b une réduction importante du risque de récidive ou de décès, avec un bénéfice durable jusqu’à près de trois ans de suivi. Les entreprises ont lancé plusieurs phases 3 : mélanome réséqué (INTerpath-001) et cancer du poumon non à petites cellules (INTerpath-002), ainsi que des phases 2 dans rein, urothélial et carcinome épidermoïde cutané. Les endpoints portent sur la survie sans maladie et la survie globale, bref les critères qui comptent pour les patients.
Dans le pancréas, terrain quasi désespéré, le pari de la personnalisation commence aussi à percer. Le vaccin autogene cevumeran (BioNTech/Roche) a suscité des réponses T spécifiques chez environ la moitié des patients, avec des signes de protection prolongée chez certains malades suivis plus de trois ans ; un essai de phase suivante est en cours. On est encore loin d’un standard, mais l’immunogénicité robuste et la tolérance répliquées dans différents rapports scientifiques valident la voie.
Autre filon américain : la prévention ciblée. Cleveland Clinic et Anixa testent un vaccin dirigé contre l’alpha-lactalbumine, protéine normalement exprimée pendant l’allaitement mais anormalement ré-exprimée dans des cancers du sein agressifs. La phase 1 finalisée indique sécurité et réponses immunes substantielles ; des discussions FDA pour phase 2 sont sur la table. Ici, l’ambition est double : retarder les récidives et, chez des populations sélectionnées, prévenir certains sous-types. Prudence méthodologique : on parle d’essai précoce, non randomisé, mais l’hypothèse biologique est solide.
Côté français, l’écosystème avance avec moins de bruit, mais des signaux sérieux. Transgene (plateforme myvac) développe TG4050, vaccin ultra-personnalisé sélectionnant des néo-antigènes via l’IA de NEC et les encodant dans un vecteur viral. En tête-cou HPV-négatif et ovaire, la phase 1 montre réponses T durables et, en adjuvant, des cohortes sans rechute sur deux ans dans le bras vacciné d’un randomisé de phase I/II, résultat spectaculaire qu’il faudra confirmer en partie II et au-delà. L’entreprise annonce la fin de randomisation de la phase II d’ici fin 2025 : la bascule vers la preuve clinique « dure » se jouera là.
Dans une approche moins custom et plus « prête à l’emploi », OSE Immunotherapeutics avance Tedopi, vaccin peptidique multi-épitopes destiné aux patients HLA-A2. Après des données encourageantes antérieures, l’essai ARTEMIA en phase 3 dans le cancer du poumon non à petites cellules (en 2ᵉ ligne, résistance secondaire aux inhibiteurs de points de contrôle) est en cours et potentiellement enregistrement si positif. Le design compare Tedopi à docétaxel avec survie comme juge. C’est un test industriel majeur pour une immunothérapie « vaccinale » non mRNA et non personnalisée.
Que faut-il retenir ? D’abord, que « vaccin contre le cancer » ne veut presque jamais dire préventif universel comme la rougeole. On parle surtout de vaccins thérapeutiques donnés après chirurgie (adjuvant) ou avant (néoadjuvant), souvent combinés à un anti-PD-1/PD-L1.
L’idée n’est pas d’empêcher tout cancer, mais de reprogrammer l’immunité pour qu’elle traque les cellules résiduelles et empêche la rechute ou la dissémination. Cette stratégie est scientifiquement cohérente : les néo-antigènes tumoraux sont propres à chaque patient, donc immunogènes, mais changeants ; d’où la personnalisation côté mRNA/IA (V940, autogene cevumeran, TG4050), ou la recherche d’épitopes partagés (Tedopi).
Ensuite, que le mur clinique arrive maintenant : la phase 3. Les effets magnifiques des petites cohortes s’y cassent parfois les dents. Les équipes de Moderna/Merck jouent franc-jeu : endpoints exigeants, populations à haut risque, concurrence d’un standard immuno déjà très efficace (Keytruda). Si la DFS (survie sans maladie) se confirme et que l’OS (survie globale) suit, V940+Keytruda pourrait devenir un standard en mélanome réséqué, puis essaimer vers le poumon. S’il échoue, la stratégie restera niche ou indication-dépendante. C’est l’année des preuves.
Troisième leçon : la logistique sera un juge de paix. Les vaccins sur-mesure exigent séquençage tumoral, bio-informatique, chaînes de production rapides. Or le cancer n’attend pas. Les industriels affûtent les cycles ; certains centres annoncent déjà des délais compatibles avec une fenêtre adjuvante post-opératoire (quelques semaines). Mais la généralisation hors hubs de pointe demandera plateformes régionales, remboursements et une standardisation des flux qu’aucun communiqué de presse ne résout.
Enfin, il faut parler de mesure. Oui, les courbes s’améliorent. Oui, des patients autrefois voués à la récidive restent sans maladie plus longtemps. Mais aucun de ces programmes n’autorise le raccourci « fin du cancer ». Le pluriel s’impose : les cancers. Biologies hétérogènes, micro-environnements immunitaires capricieux, échappements multiples. Le vaccin ne sera ni baguette magique ni gadget ; il s’ajoute à la chirurgie, à la radiothérapie, aux thérapies ciblées, à l’immuno, pour faire basculer le pronostic d’un sous-ensemble croissant de patients. Et c’est déjà énorme.
Comparons, pour finir, avec les annonces tonitruantes venues d’ailleurs. Affirmer des efficacités « à 100 % » en préclinique, ou promettre l’« usage clinique » avant toute phase humaine solide, n’a aucune valeur au standard international. La science n’interdit pas l’optimisme, elle l’ordonne : d’abord publier, ensuite reproduire, puis généraliser. Ce qui crédibilise aujourd’hui les pistes américaine et française, c’est précisément la publication dans des revues à comité de lecture, le lancement d’essais randomisés et le choix d’endpoints durs. Là se joue la différence entre promesse et preuve.
Alors, « le cancer, c’est bientôt la fin » ? Non, et ce n’est pas grave : la fin de certains scénarios du cancer, oui. Le mélanome à haut risque pourrait devenir, demain, moins récidivant. Des niches réputées intraitables (pancréas) laissent entrevoir des répondeurs durables. Des approches hybrides (prévention ciblée du sein, vaccins standardisables comme Tedopi) pourraient élargir l’accès. La révolution est moins un feu d’artifice qu’un travail d’orfèvre : mutation par mutation, patient par patient, coupe après coupe, la médecine façonne un nouvel équilibre avec la maladie. L’espoir n’est pas un hashtag ; c’est une méthode qui, ligne après ligne de protocole, déplace la frontière.
À surveiller, très concrètement, dans les prochains mois : les lectures intermédiaires des phases 3 V940+Keytruda (mélanome, puis poumon) ; la mise en phase 2 du vaccin alpha-lactalbumine à Cleveland ; la lecture d’ARTEMIA pour Tedopi ; et la poursuite des essais BioNTech/Roche au pancréas, avec des critères cliniques irréprochables. Si deux ou trois de ces dominos tombent dans le bon sens, l’expression « vaccin contre le cancer » cessera d’être une formule polémique pour devenir un outil clinique à part entière. Et là, sans fracas, certains cancers vivront leurs derniers beaux jours.
Enteromix : l’espoir vient-il vraiment de Moscou ?
L’annonce d’Enteromix, présenté comme le premier vaccin russe contre le cancer, a résonné dans les médias comme une victoire scientifique et patriotique. Moscou n’a pas hésité à mettre en avant un discours percutant : une efficacité annoncée proche de 100 % dans les essais précliniques, une technologie moderne à base d’ARN messager, et la promesse que le traitement serait bientôt gratuit pour les patients.
Sur le papier, tout est là pour alimenter l’idée d’une percée historique. Mais au-delà de l’effet d’annonce, les données disponibles racontent une histoire plus nuancée. Enteromix cible d’abord le cancer colorectal, mais les chercheurs russes évoquent aussi des pistes sur le glioblastome et le mélanome. Les résultats cités proviennent essentiellement d’expériences en laboratoire ou sur modèles animaux, ce qui n’est pas anodin : dans l’histoire récente de l’oncologie, des centaines de molécules se sont montrées prometteuses en préclinique avant d’échouer dans les essais humains. Autrement dit, l’écart entre un effet spectaculaire dans une boîte de Petri et un bénéfice tangible chez un patient reste abyssal.
La prudence est d’autant plus de mise que les autorités russes ont communiqué sans publier d’article scientifique détaillant méthodologie, taille des cohortes ou données brutes.
Dans les standards internationaux, une avancée de cette ampleur doit passer par des revues à comité de lecture, des essais cliniques en phase I puis II, et une validation par des agences indépendantes. À ce stade, aucune preuve publique ne permet d’affirmer que le vaccin est déjà prêt pour un usage humain généralisé. C’est d’ailleurs le point soulevé par plusieurs experts occidentaux : l’enthousiasme russe s’explique peut-être autant par des raisons de prestige géopolitique que par une réalité scientifique incontestable. Après tout, Moscou avait déjà surpris le monde en annonçant, dès 2020, Spoutnik V comme premier vaccin anti-Covid avant même les validations occidentales. Le parallèle est tentant : stratégie de communication agressive, course au symbole, volonté d’apparaître en tête de la compétition biotechnologique.
Faut-il pour autant balayer Enteromix comme un simple coup médiatique ? Pas nécessairement. La piste immunologique du vaccin thérapeutique anticancer est l’une des plus sérieuses et les recherches mondiales convergent dans ce sens, qu’elles viennent des laboratoires américains ou français.
Si les chercheurs russes parviennent à transformer leurs résultats précliniques en succès cliniques reproductibles, Moscou pourrait bel et bien revendiquer une avance inattendue.
Pour l’instant, l’espoir reste suspendu à un fil : il faudra attendre des essais humains rigoureux, publiés et évalués, pour savoir si le miracle annoncé est une réalité thérapeutique… ou un mirage diplomatique.
Sur le papier, tout est là pour alimenter l’idée d’une percée historique. Mais au-delà de l’effet d’annonce, les données disponibles racontent une histoire plus nuancée. Enteromix cible d’abord le cancer colorectal, mais les chercheurs russes évoquent aussi des pistes sur le glioblastome et le mélanome. Les résultats cités proviennent essentiellement d’expériences en laboratoire ou sur modèles animaux, ce qui n’est pas anodin : dans l’histoire récente de l’oncologie, des centaines de molécules se sont montrées prometteuses en préclinique avant d’échouer dans les essais humains. Autrement dit, l’écart entre un effet spectaculaire dans une boîte de Petri et un bénéfice tangible chez un patient reste abyssal.
La prudence est d’autant plus de mise que les autorités russes ont communiqué sans publier d’article scientifique détaillant méthodologie, taille des cohortes ou données brutes.
Dans les standards internationaux, une avancée de cette ampleur doit passer par des revues à comité de lecture, des essais cliniques en phase I puis II, et une validation par des agences indépendantes. À ce stade, aucune preuve publique ne permet d’affirmer que le vaccin est déjà prêt pour un usage humain généralisé. C’est d’ailleurs le point soulevé par plusieurs experts occidentaux : l’enthousiasme russe s’explique peut-être autant par des raisons de prestige géopolitique que par une réalité scientifique incontestable. Après tout, Moscou avait déjà surpris le monde en annonçant, dès 2020, Spoutnik V comme premier vaccin anti-Covid avant même les validations occidentales. Le parallèle est tentant : stratégie de communication agressive, course au symbole, volonté d’apparaître en tête de la compétition biotechnologique.
Faut-il pour autant balayer Enteromix comme un simple coup médiatique ? Pas nécessairement. La piste immunologique du vaccin thérapeutique anticancer est l’une des plus sérieuses et les recherches mondiales convergent dans ce sens, qu’elles viennent des laboratoires américains ou français.
Si les chercheurs russes parviennent à transformer leurs résultats précliniques en succès cliniques reproductibles, Moscou pourrait bel et bien revendiquer une avance inattendue.
Pour l’instant, l’espoir reste suspendu à un fil : il faudra attendre des essais humains rigoureux, publiés et évalués, pour savoir si le miracle annoncé est une réalité thérapeutique… ou un mirage diplomatique.
Pour rappel, le vaccin Spoutnik V a bien été dénigré au débat pour connaître une reconnaissance par la suite, mais pas de validation complète exhaustive.
Spoutnik V a bénéficié d’une reconnaissance scientifique réelle : publication dans une revue à comité de lecture prestigieuse (The Lancet), efficacité élevée confirmée dans des essais à large échelle, autorisations dans plusieurs pays, et un examen par des organismes internationaux comme l’EMA.
Toutefois, il n’a pas, à ce jour, obtenu une autorisation complète et définitive dans l’Union européenne, en partie à cause de données jugées insuffisantes ou incomplètes par les régulateurs. Bref, la promesse est validée sur plusieurs fronts, mais pas encore universellement ni définitivement.
Toutefois, il n’a pas, à ce jour, obtenu une autorisation complète et définitive dans l’Union européenne, en partie à cause de données jugées insuffisantes ou incomplètes par les régulateurs. Bref, la promesse est validée sur plusieurs fronts, mais pas encore universellement ni définitivement.












 L'accueil
L'accueil