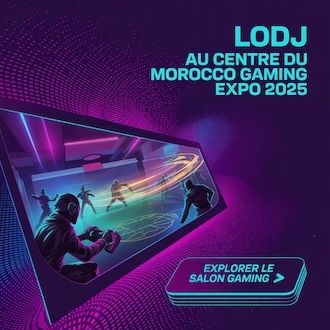7ème Sens avec Tariq Akdim / Enseignant/ Économiste spécialisé en politique Territoriale.
L'inflation alimentaire est au centre des préoccupations, révélant des failles structurelles dans l'économie. Elle est notamment liée à l'incapacité d'améliorer la productivité sur les marchés, malgré des investissements étatiques conséquents. Cette stagnation économique freine la création d'emplois et renforce les inégalités sociales.
Le débat soulève également des questions éthiques, notamment sur la spéculation et les comportements jugés immoraux dans les chaînes de valeur. Une meilleure politique d'emploi aurait pu contribuer à une croissance économique plus robuste, mais les efforts actuels restent insuffisants pour répondre aux attentes.
La gestion des intermédiaires économiques constitue un défi majeur. Ces acteurs, souvent accusés de spéculation, opèrent dans une zone grise où des marges importantes sont réalisées entre l'offre et la logistique. L'absence de textes législatifs clairs complique davantage leur régulation.
Depuis 2014, la loi 104-12 sur la liberté des prix et la concurrence interdit à l'État d'intervenir directement dans la fixation des prix. Cependant, cette liberté a favorisé l'émergence d'acteurs informels difficilement contrôlables. Une révision de cette loi, adaptée au contexte actuel, est jugée nécessaire pour renforcer la transparence et la confiance sur les marchés.
La hausse des prix des produits de première nécessité, comme le kilo de sardines à 25 dirhams, met en lumière les limites de l'action gouvernementale. Bien que des subventions soient maintenues pour des produits essentiels tels que le gaz butane, le sucre et la farine, leur impact sur le pouvoir d'achat des ménages reste à évaluer.
L'État est appelé à jouer un rôle plus actif pour garantir l'équilibre social et apaiser les tensions liées à l'inflation. La paix sociale, en période de crise économique, dépend en grande partie de la capacité des autorités à intervenir efficacement sur les marchés.
Une politique d'emploi plus ambitieuse aurait pu améliorer la croissance économique de 2 à 3 points selon les experts. Cependant, le lien entre l'inflation alimentaire et la détérioration de l'emploi reste préoccupant.
Les efforts du gouvernement pour revitaliser la charte d'investissement sont notables, mais les chiffres officiels sur la création d'emplois suscitent des doutes. Le programme actuel, qui vise à créer 350 000 emplois d'ici 2026, semble insuffisant face à un taux de chômage de 13,3 %. De plus, les secteurs générant le plus d'emplois, comme les services et la construction, peinent à compenser le déclin de la création d'emplois publics.
Pour lutter contre l'inflation alimentaire et le chômage, les experts appellent à un "choc d'offre" et à une réforme fiscale ciblée. Il est essentiel d'encourager les investissements dans les régions moins développées, où les opportunités économiques sont rares.
Actuellement, la majorité des nouvelles entreprises se concentrent dans les régions riches comme Tanger et Casablanca, accentuant les disparités régionales. Une fiscalité territoriale adaptée pourrait stimuler l'attractivité des zones défavorisées et contribuer à une répartition plus équitable des ressources.
Enfin, la création d'emplois ne peut être planifiée sans une augmentation significative de la production. Les investissements publics, bien que massifs, doivent être mieux orientés pour maximiser leur rentabilité et répondre aux besoins réels de l'économie marocaine.
Le débat soulève également des questions éthiques, notamment sur la spéculation et les comportements jugés immoraux dans les chaînes de valeur. Une meilleure politique d'emploi aurait pu contribuer à une croissance économique plus robuste, mais les efforts actuels restent insuffisants pour répondre aux attentes.
La gestion des intermédiaires économiques constitue un défi majeur. Ces acteurs, souvent accusés de spéculation, opèrent dans une zone grise où des marges importantes sont réalisées entre l'offre et la logistique. L'absence de textes législatifs clairs complique davantage leur régulation.
Depuis 2014, la loi 104-12 sur la liberté des prix et la concurrence interdit à l'État d'intervenir directement dans la fixation des prix. Cependant, cette liberté a favorisé l'émergence d'acteurs informels difficilement contrôlables. Une révision de cette loi, adaptée au contexte actuel, est jugée nécessaire pour renforcer la transparence et la confiance sur les marchés.
La hausse des prix des produits de première nécessité, comme le kilo de sardines à 25 dirhams, met en lumière les limites de l'action gouvernementale. Bien que des subventions soient maintenues pour des produits essentiels tels que le gaz butane, le sucre et la farine, leur impact sur le pouvoir d'achat des ménages reste à évaluer.
L'État est appelé à jouer un rôle plus actif pour garantir l'équilibre social et apaiser les tensions liées à l'inflation. La paix sociale, en période de crise économique, dépend en grande partie de la capacité des autorités à intervenir efficacement sur les marchés.
Une politique d'emploi plus ambitieuse aurait pu améliorer la croissance économique de 2 à 3 points selon les experts. Cependant, le lien entre l'inflation alimentaire et la détérioration de l'emploi reste préoccupant.
Les efforts du gouvernement pour revitaliser la charte d'investissement sont notables, mais les chiffres officiels sur la création d'emplois suscitent des doutes. Le programme actuel, qui vise à créer 350 000 emplois d'ici 2026, semble insuffisant face à un taux de chômage de 13,3 %. De plus, les secteurs générant le plus d'emplois, comme les services et la construction, peinent à compenser le déclin de la création d'emplois publics.
Pour lutter contre l'inflation alimentaire et le chômage, les experts appellent à un "choc d'offre" et à une réforme fiscale ciblée. Il est essentiel d'encourager les investissements dans les régions moins développées, où les opportunités économiques sont rares.
Actuellement, la majorité des nouvelles entreprises se concentrent dans les régions riches comme Tanger et Casablanca, accentuant les disparités régionales. Une fiscalité territoriale adaptée pourrait stimuler l'attractivité des zones défavorisées et contribuer à une répartition plus équitable des ressources.
Enfin, la création d'emplois ne peut être planifiée sans une augmentation significative de la production. Les investissements publics, bien que massifs, doivent être mieux orientés pour maximiser leur rentabilité et répondre aux besoins réels de l'économie marocaine.
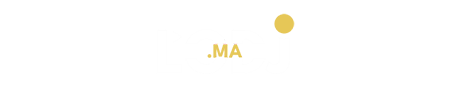











 L'accueil
L'accueil