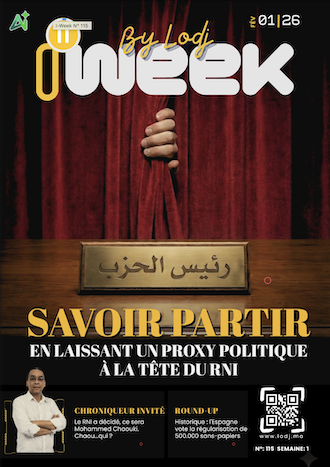Le Maroc a voulu cette CAN comme la meilleure de l’histoire.
Il s’est engagé sans retenue, avec une générosité assumée, convaincu que l’exemplarité organisationnelle, l’hospitalité, le respect des traditions et la qualité de l’accueil constitueraient un socle solide de reconnaissance.
Infrastructures, sécurité, mobilisation humaine, atmosphère populaire : tout a été mis en œuvre pour que cette CAN soit une réussite partagée et qu’elle serve autant le football africain que l’image du Royaume.
Et pourtant, l’après-CAN a révélé un malaise profond.
Ce choc ne tient pas seulement à la sanction elle-même, mais à ce qu’elle révèle : l’idée que donner le meilleur de soi ne protège pas nécessairement, que la bonne foi ne garantit ni l’équité ni la reconnaissance.
Malgré le discours royal d’apaisement, responsable et soucieux de préserver l’essentiel, la blessure reste vive dans l’opinion publique. Les réseaux sociaux, les débats informels et les conversations ordinaires traduisent un même sentiment : celui d’un investissement massif qui n’a pas trouvé en retour le respect attendu.
À cela s’ajoutent des narratifs hostiles, des fake news et des provocations, qui prospèrent précisément dans cet espace de frustration.
C’est à ce moment précis que la réflexion sur le soft power devient incontournable.
Mais elle a également mis en lumière les limites du soft power lorsqu’il est pensé comme une fin en soi.
Le soft power, tel que conceptualisé par Joseph Nye à la fin des années 1980, repose sur l’attraction : séduire plutôt que contraindre, convaincre plutôt qu’imposer. Il naît du constat que la puissance brute ne suffit pas à produire de l’adhésion. Mais le soft power échoue précisément lorsqu’on lui prête plus qu’il ne peut offrir.
La première illusion est celle de la conversion automatique.
On peut admirer une organisation sans reconnaître l’autorité ou la légitimité de l’acteur qui l’incarne. Cette confusion entre attraction culturelle et adhésion politique est au cœur de l’échec du soft power pris isolément.
La seconde limite, plus profonde encore, tient à la question identitaire. L’identité, lorsqu’elle se cristallise, n’est pas compatible avec le soft power. Elle agit comme un contre-soft power.
Là où le soft power cherche l’adhésion, l’identité affirmée organise la résistance. Elle se construit par distinction, parfois par opposition, et apprend à se méfier de toute tentative de séduction venue de l’extérieur.
Dans ce cadre, le soft power est souvent perçu non comme une invitation, mais comme une manœuvre. Il est mis en accusation précisément par ceux qu’il est censé atteindre.
La bataille cesse alors d’être culturelle ou symbolique ; elle devient identitaire. Et dans une bataille identitaire, le soft power est largement désarmé.
La CAN 2025 en a donné une illustration frappante.
Mon imaginaire se construit contre le tien, et non avec toi. Dans ce schéma, la séduction ne fonctionne plus. À cela s’ajoute une autre illusion, ancienne mais persistante : celle du messianisme culturel.
De Jules Ferry aux formes contemporaines de diplomatie occidentale, l’histoire regorge de cette croyance selon laquelle une culture jugée supérieure finirait par s’imposer naturellement. Hollywood, Coca-Cola ou McDonald’s ont longtemps incarné cette vision d’un monde converti par la diffusion culturelle.
Or l’histoire a montré que cette diffusion n’engendre ni adhésion politique ni reconnaissance automatique. Elle provoque souvent l’effet inverse : rejet, crispation et repli identitaire.
Appliquée au cas marocain, cette illusion conduit à croire que l’hospitalité, la générosité et la bienveillance , jusque dans les détails les plus fins de l’accueil, du lait et dattes, des cornes de gazelle aux gestes du quotidien , suffiraient à garantir respect et équité.
Or la diplomatie n’est pas une affaire de symboles aimables.
Elle est un art complexe de gestion des rapports de force symboliques, institutionnels et narratifs. C’est précisément pour répondre à ces échecs que Joseph Nye, puis Suzanne Nossel, introduisent le concept de smart power.
Le smart power naît du constat que le soft power, livré à lui-même, échoue pour des raisons structurelles.
Il pose une question décisive : comment transformer l’attraction en influence réelle, et l’influence en avantage stratégique durable. Le smart power suppose l’anticipation des réactions identitaires, la maîtrise des récits hostiles, la capacité à poser des limites sans renoncer aux valeurs et, surtout, l’affirmation claire des intérêts nationaux.
Dans cette perspective, certaines décisions récentes ne relèvent ni du repli ni de la colère, mais d’un choix stratégique assumé : refuser que la générosité devienne une asymétrie permanente.
Comme le rappelle Bertrand Badie, nous assistons aujourd’hui à une renaissance de la diplomatie, entendue non comme domination, mais comme art de gérer les séparations, de reconnaître l’altérité et d’accepter que l’autre ne nous ressemble pas.
La diplomatie de l’influence ne consiste plus à séduire naïvement, mais à composer avec la différence et à négocier avec des identités irréductibles.
Le Maroc n’a pas échoué dans l’organisation de la CAN 2025. Il a réussi.
Le soft power marocain existe, il est réel et précieux. Mais sans smart power pour le cadrer, le protéger et l’orienter, il atteint aujourd’hui ses limites. Séduire reste une force. Défendre ses intérêts devient une nécessité.
C’est à cette condition que le Maroc pourra continuer à rayonner sans se fragiliser, à donner sans s’effacer et à agir avec lucidité dans un environnement devenu profondément conflictuel.
Par Omar Hasnaoui :
- Diplomate de carrière.
- Président et fondateur de la Fondation Hélios.












 L'accueil
L'accueil





 L’intelligence artificielle au Maroc : de l’écosystème à l’impact, le véritable défi
L’intelligence artificielle au Maroc : de l’écosystème à l’impact, le véritable défi