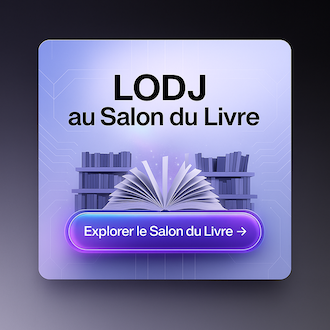Par Hicham EL AADNANI Consultant en intelligence stratégique
La signature, ce jour, de trois protocoles d'accord entre le Maroc et les Émirats arabes unis marque un tournant décisif dans les relations bilatérales entre ces deux nations, tout en illustrant une reconfiguration substantielle des alliances stratégiques dans la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord). Ces accords, couvrant les secteurs névralgiques de l'eau, de l'énergie et de l'industrie, s'inscrivent dans une vision multidimensionnelle qui transcende la simple coopération économique pour embrasser une restructuration profonde des capacités infrastructurelles du Royaume.
Le programme, porté par un consortium d'institutions nationales marocaines - l'Office National de l'Électricité et de l'Eau potable (ONEE), Taqa Maroc, Nareva, et le Fonds Mohammed VI pour l'Investissement (FM6I) - représente un investissement colossal de 150 milliards de dirhams. Cette mobilisation financière considérable témoigne de l'ambition transformative du projet, conçu comme une réponse systémique aux défis interconnectés de la sécurité hydrique et énergétique auxquels le Maroc est confronté dans un contexte de changement climatique accéléré.
La dimension hydrique : réponse stratégique à une vulnérabilité structurelle
La carte suivante (source : communiqué conjoint) dévoile l'architecture complexe d'un réseau hydraulique ambitieux, articulé autour de plusieurs pôles de dessalement répartis stratégiquement sur le littoral marocain. Cette configuration spatiale n'est pas fortuite ; elle répond à une analyse minutieuse des vulnérabilités hydriques du territoire et à une anticipation des tensions croissantes sur les ressources en eau conventionnelles.
Le projet prévoit également le transfert massif de 800 millions de mètres cubes d'eau par an entre différents bassins hydrauliques, notamment depuis le bassin de Sebou vers celui d'Oum Er Rbia. Cette interconnexion des bassins versants constitue une réponse technique à la disparité géographique des ressources hydriques sur le territoire marocain. Parallèlement, le programme ambitionne de produire 900 millions de mètres cubes d'eau dessalée annuellement, répartis entre plusieurs stations stratégiquement positionnées :
• La région de l'Oriental : 300 millions de m³/an
• Souss Massa : 350 millions de m³/an
• Tanger : 150 millions de m³/an
• Guelmim et Tan Tan : environ 50 millions de m³/an chacune
Cette distribution spatiale des capacités de dessalement révèle une lecture fine des besoins territoriaux différenciés et une volonté d'équilibrage des ressources à l'échelle nationale. La concentration des plus grandes capacités dans les régions de l'Oriental et de Souss Massa n'est pas anodine : elle correspond aux zones connaissant les déficits hydriques les plus critiques et abritant des activités économiques stratégiques, notamment agricoles et touristiques, particulièrement vulnérables au stress hydrique.
L'articulation énergétique : vers une souveraineté électrique décarbonée
La dimension énergétique du programme révèle une approche intégrée particulièrement sophistiquée. L'innovation majeure réside dans le couplage systématique des infrastructures de dessalement avec des capacités de production d'énergie renouvelable. Cette symbiose techno-économique permet de résoudre l'une des principales contradictions inhérentes au dessalement conventionnel : son intensité énergétique élevée et, par conséquent, son empreinte carbone significative.
Le programme prévoit le déploiement de 1200 MW de nouvelles capacités de production d'énergie renouvelable, principalement éolienne, comme l'illustre le projet "Éolien IPP" de 1200 MW situé dans la région de Dakhla. Cette localisation n'est pas fortuite : elle capitalise sur l'un des gisements éoliens les plus constants et puissants du continent africain.
Parallèlement, le développement d'une "autoroute électrique" de 1400 km, utilisant la technologie HVDC (High Voltage Direct Current) à 3 GW, constitue une avancée infrastructurelle majeure. Cette solution de transport d'électricité à haute efficience permet d'interconnecter des zones de production d'énergie renouvelable, souvent éloignées des centres de consommation, avec les principaux pôles de demande énergétique du pays, notamment les stations de dessalement et les centres urbains et industriels.
La centrale à cycle combiné gaz (CCGT) de Tahaddart, d'une capacité de 1500 MW, vient compléter ce dispositif en assurant la stabilité du réseau électrique national face à l'intermittence intrinsèque des énergies renouvelables. Ce choix technologique, bien que reposant sur une énergie fossile, représente un compromis pragmatique entre impératif de décarbonation et nécessité de garantir la sécurité d'approvisionnement électrique.
La gouvernance institutionnelle : un modèle de synergie public-privé
Au cœur de l'architecture institutionnelle de ce programme ambitieux, le ministère de l'Équipement et de l'Eau occupe une position stratégique d'orchestration et de pilotage. Sa forte implication reflète l'élévation de la question hydrique au rang de priorité nationale et sa reconnaissance comme vecteur essentiel de développement territorial équilibré. Le ministère apporte non seulement son expertise technique dans la conception des infrastructures de transfert interbassins et des stations de dessalement, mais également sa vision stratégique de long terme pour une gestion intégrée des ressources en eau à l'échelle nationale.
Cette implication ministérielle directe dans la gouvernance du programme constitue un facteur clé de légitimation politique et de mobilisation des différentes parties prenantes. Le ministère assure l'harmonisation entre les objectifs du programme et les orientations du nouveau Plan National de l'Eau, garantissant ainsi la cohérence de l'action publique dans un secteur particulièrement sensible. Sa participation active aux négociations avec les partenaires émiratis témoigne également de l'importance accordée à ce partenariat stratégique au plus haut niveau de l'État marocain.
Le modèle de gouvernance adopté illustre une approche innovante de collaboration entre institutions publiques (ministère, ONEE) et acteurs privés ou mixtes (Taqa Morocco, Nareva, FM6I), préfigurant potentiellement un nouveau paradigme d'action publique dans les secteurs stratégiques au Maroc. Cette configuration institutionnelle hybride vise à combiner la vision stratégique et la légitimité de l'action publique avec la flexibilité opérationnelle et la capacité d'innovation du secteur privé.
Les implications géoéconomiques et sociopolitiques : au-delà de l'infrastructure
Ce programme de développement transcende largement sa dimension technico-économique pour s'inscrire dans une reconfiguration profonde des équilibres géopolitiques régionaux. L'implication des Émirats arabes unis dans un projet aussi stratégique pour la souveraineté hydrique et énergétique du Maroc témoigne d'une inflexion significative dans les alliances traditionnelles au sein du monde arabe.
Cette coopération bilatérale renforcée intervient dans un contexte de recomposition des relations de pouvoir à l'échelle méditerranéenne et africaine, où le Maroc cherche à affirmer son positionnement de puissance régionale émergente. Le choix d'un partenariat avec les Émirats plutôt qu'avec d'autres acteurs régionaux ou internationaux n'est pas anodin ; il reflète une convergence d'intérêts et de visions stratégiques entre deux monarchies qui partagent certaines similitudes dans leurs modèles de gouvernance et leurs ambitions de diversification économique.
De plus, ces accords s'inscrivent pleinement dans le prolongement de la déclaration conjointe historique signée le 4 décembre 2023 entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyane, qui avait posé les jalons d'un partenariat stratégique renouvelé entre les deux nations. Cette déclaration constitue désormais le cadre de référence politique et diplomatique qui guide l'approfondissement des relations bilatérales dans les secteurs considérés comme prioritaires pour la souveraineté nationale et le développement durable des deux pays.
Sur le plan socioéconomique national, la promesse de création de plus de 25 000 emplois directs et indirects constitue un levier potentiel de légitimation politique du programme auprès des populations. Cette dimension sociale est d'autant plus cruciale que le Maroc connaît des tensions récurrentes liées à l'accès à l'eau, particulièrement dans les régions rurales et périurbaines, où les inégalités d'accès aux services essentiels demeurent prononcées.
L'ambition de développer une filière industrielle locale spécialisée dans les technologies de dessalement et d'énergie renouvelable révèle également une volonté de transcender le simple transfert technologique pour engager une véritable montée en compétence de l'écosystème industriel marocain. Cette orientation s'inscrit dans la continuité de la stratégie d'industrialisation poursuivie par le Maroc depuis plus d'une décennie, visant à positionner le pays comme plateforme industrielle compétitive à l'échelle régionale.
Conclusion : vers un nouveau paradigme de développement territorial ?
Le programme maroco-émirati de sécurisation hydrique et énergétique représente indéniablement une rupture conceptuelle dans l'approche des défis infrastructurels au Maroc et, plus largement, dans la région MENA. En intégrant dans une même vision stratégique les questions hydriques, énergétiques et industrielles, il propose un modèle de développement qui transcende les approches sectorielles traditionnelles.
Cette initiative s'inscrit dans un contexte global où la question des ressources - eau, énergie, terres cultivables - devient un enjeu géopolitique central, particulièrement dans les régions confrontées aux effets les plus aigus du changement climatique. Le programme peut ainsi être interprété comme une réponse anticipative du Maroc à des tensions qui ne manqueront pas de s'intensifier à l'horizon 2030 et au-delà.
Au-delà de sa dimension nationale, ce partenariat stratégique entre le Maroc et les Émirats arabes unis pourrait préfigurer l'émergence de nouvelles configurations coopératives dans le monde arabe, davantage axées sur le développement durable et la sécurité des ressources que sur les considérations géopolitiques traditionnelles. Il illustre également la capacité croissante de certains États de la région à mobiliser des ressources financières et techniques considérables pour répondre à des défis structurels, sans dépendre exclusivement des institutions financières internationales ou des puissances occidentales.
L'évolution de ce programme dans les années à venir constituera un indicateur précieux de la capacité du Maroc à transformer ses ambitions stratégiques en réalisations concrètes, et plus largement, de la faisabilité d'un modèle de développement qui tente de concilier impératifs de souveraineté, exigences de durabilité et nécessité d'inclusion sociale.
Par Hicham EL AADNANI
Consultant en intelligence stratégique












 L'accueil
L'accueil