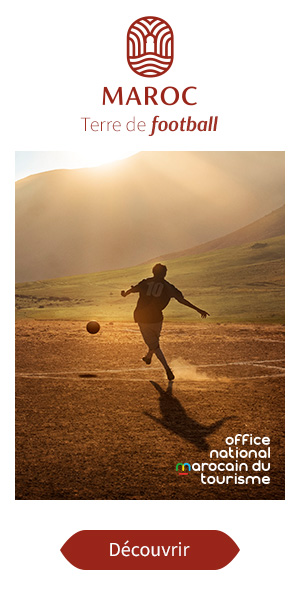Vers la fin des mollahs ? Le rôle clé d’une opposition prête à renaître
La guerre actuelle entre l’Iran et Israël ne se joue pas seulement sur le terrain militaire ou dans les airs, mais dans les esprits, les rues et les exils. Elle ravive une question brûlante et taboue depuis quarante-cinq ans : et si ce conflit ouvrait une brèche pour un changement de régime à Téhéran ? L’opposition iranienne, bien que divisée, incarne un espoir renaissant pour une population lassée de la violence politique, de l’isolement économique et du fanatisme religieux. Ce régime des mollahs, né en 1979 de la Révolution islamique, s’est peu à peu sclérosé dans une paranoïa sécuritaire, une corruption endémique, et une obsession pour la projection de puissance à l’étranger, au détriment de son propre peuple.
La jeunesse iranienne, instruite, connectée et largement désenchantée par les promesses révolutionnaires, ne rêve plus de martyr mais de liberté, d’émancipation et de dignité. Depuis les grandes manifestations de 2009, en passant par le soulèvement de 2019, jusqu’au mouvement de 2022 contre l’oppression des femmes, le peuple iranien a prouvé sa résilience et sa capacité à se mobiliser, malgré une répression d’une brutalité extrême. Ce potentiel insurrectionnel n’est pas mort. Il dort, il attend. Et la guerre actuelle pourrait agir comme un catalyseur. L’ampleur des tensions militaires avec Israël fragilise les Gardiens de la Révolution, expose les divisions internes du pouvoir, et ravive l’impatience populaire.
De l’extérieur, l’opposition iranienne en exil, longtemps morcelée et marginalisée, s’organise avec plus de discipline. Des figures comme Reza Pahlavi (héritier du trône), ou les militantes laïques comme Masih Alinejad, s’imposent comme des visages familiers dans les médias internationaux. Ils offrent des récits alternatifs, défendent une transition pacifique et démocratique, et créent des ponts entre la diaspora et les mouvements internes. Le renversement du régime des mollahs ne relèverait plus de l’utopie. Il pourrait s’imposer comme un impératif historique. Car ce régime, qui repose sur la peur, pourrait s’effondrer dès lors qu’il perdrait la capacité de la faire régner. La guerre avec Israël est donc peut-être le point de bascule. Si le peuple iranien parvient à se soulever au moment où l’élite militaire est concentrée sur l’affrontement externe, alors l’Histoire pourrait tourner. Et l’Iran, redevenir une nation libre.
La jeunesse iranienne, instruite, connectée et largement désenchantée par les promesses révolutionnaires, ne rêve plus de martyr mais de liberté, d’émancipation et de dignité. Depuis les grandes manifestations de 2009, en passant par le soulèvement de 2019, jusqu’au mouvement de 2022 contre l’oppression des femmes, le peuple iranien a prouvé sa résilience et sa capacité à se mobiliser, malgré une répression d’une brutalité extrême. Ce potentiel insurrectionnel n’est pas mort. Il dort, il attend. Et la guerre actuelle pourrait agir comme un catalyseur. L’ampleur des tensions militaires avec Israël fragilise les Gardiens de la Révolution, expose les divisions internes du pouvoir, et ravive l’impatience populaire.
De l’extérieur, l’opposition iranienne en exil, longtemps morcelée et marginalisée, s’organise avec plus de discipline. Des figures comme Reza Pahlavi (héritier du trône), ou les militantes laïques comme Masih Alinejad, s’imposent comme des visages familiers dans les médias internationaux. Ils offrent des récits alternatifs, défendent une transition pacifique et démocratique, et créent des ponts entre la diaspora et les mouvements internes. Le renversement du régime des mollahs ne relèverait plus de l’utopie. Il pourrait s’imposer comme un impératif historique. Car ce régime, qui repose sur la peur, pourrait s’effondrer dès lors qu’il perdrait la capacité de la faire régner. La guerre avec Israël est donc peut-être le point de bascule. Si le peuple iranien parvient à se soulever au moment où l’élite militaire est concentrée sur l’affrontement externe, alors l’Histoire pourrait tourner. Et l’Iran, redevenir une nation libre.
Le rêve d’un changement de régime, un piège géopolitique ?
Mais croire que la guerre avec Israël pourrait mécaniquement provoquer un changement de régime en Iran relève d’un pari à haut risque. Non seulement parce que l’opposition iranienne reste extrêmement fragmentée et peu représentative de la diversité réelle du pays, mais aussi parce qu’un effondrement du régime des mollahs — aussi autoritaire soit-il — pourrait ouvrir une ère de chaos encore plus destructrice pour l’Iran et toute la région.
L’histoire récente du Moyen-Orient nous met en garde : la chute brutale de régimes de l’Irak de Saddam Hussein à la Libye de Kadhafi, n’a pas engendré la démocratie mais l’effondrement des institutions, la guerre civile, et la montée en puissance de forces encore plus radicales.
Le régime iranien, malgré son caractère théocratique, reste profondément enraciné dans des structures de pouvoir complexes, incluant les Gardiens de la Révolution, le clergé chiite, les réseaux économiques parallèles et les services de renseignement. Une opposition extérieure, même médiatiquement présente, n’a ni les relais, ni la légitimité populaire suffisante pour garantir une transition stable. La figure de Reza Pahlavi reste entachée par le souvenir du Shah et de la Savak. Quant aux mouvements laïques ou féministes, s’ils sont puissants en diaspora, leur capacité à s’imposer en Iran même reste marginale, sous surveillance constante, et infiltrée. L’idée d’un soulèvement populaire coordonné avec un conflit extérieur risque d’apparaître, pour de nombreux Iraniens, comme une manipulation occidentale — et renforcer le nationalisme plutôt que de l’éroder.
En outre, en pleine guerre, appeler à un changement de régime revient à saboter toute perspective de désescalade. Cela conforte le régime iranien dans sa rhétorique paranoïaque : « l’ennemi veut nous détruire ». Et dans ce contexte, toute contestation interne est immédiatement étiquetée comme traîtrise. Une telle dynamique pourrait même prolonger la survie du régime en renforçant l’état d’urgence et en réprimant encore plus violemment toute dissidence. L’opposition, en misant sur l’effondrement plutôt que sur la réforme, risque de compromettre ce qui reste d’espace politique. Par ailleurs, une guerre qui mènerait à un changement de régime téléguidé ou encouragé de l’extérieur donnerait à l’Iran une place de victime sur la scène internationale, au moment même où la région aurait besoin d’une sortie politique, pas d’un nouvel effondrement étatique.
L’opposition iranienne incarne un espoir pour une société en quête de liberté, mais elle doit se méfier de l’illusion de la guerre libératrice. Un changement de régime crédible ne peut naître que d’une dynamique interne, maîtrisée, et souveraine — pas d’un effondrement sous les bombes.
L’histoire récente du Moyen-Orient nous met en garde : la chute brutale de régimes de l’Irak de Saddam Hussein à la Libye de Kadhafi, n’a pas engendré la démocratie mais l’effondrement des institutions, la guerre civile, et la montée en puissance de forces encore plus radicales.
Le régime iranien, malgré son caractère théocratique, reste profondément enraciné dans des structures de pouvoir complexes, incluant les Gardiens de la Révolution, le clergé chiite, les réseaux économiques parallèles et les services de renseignement. Une opposition extérieure, même médiatiquement présente, n’a ni les relais, ni la légitimité populaire suffisante pour garantir une transition stable. La figure de Reza Pahlavi reste entachée par le souvenir du Shah et de la Savak. Quant aux mouvements laïques ou féministes, s’ils sont puissants en diaspora, leur capacité à s’imposer en Iran même reste marginale, sous surveillance constante, et infiltrée. L’idée d’un soulèvement populaire coordonné avec un conflit extérieur risque d’apparaître, pour de nombreux Iraniens, comme une manipulation occidentale — et renforcer le nationalisme plutôt que de l’éroder.
En outre, en pleine guerre, appeler à un changement de régime revient à saboter toute perspective de désescalade. Cela conforte le régime iranien dans sa rhétorique paranoïaque : « l’ennemi veut nous détruire ». Et dans ce contexte, toute contestation interne est immédiatement étiquetée comme traîtrise. Une telle dynamique pourrait même prolonger la survie du régime en renforçant l’état d’urgence et en réprimant encore plus violemment toute dissidence. L’opposition, en misant sur l’effondrement plutôt que sur la réforme, risque de compromettre ce qui reste d’espace politique. Par ailleurs, une guerre qui mènerait à un changement de régime téléguidé ou encouragé de l’extérieur donnerait à l’Iran une place de victime sur la scène internationale, au moment même où la région aurait besoin d’une sortie politique, pas d’un nouvel effondrement étatique.
L’opposition iranienne incarne un espoir pour une société en quête de liberté, mais elle doit se méfier de l’illusion de la guerre libératrice. Un changement de régime crédible ne peut naître que d’une dynamique interne, maîtrisée, et souveraine — pas d’un effondrement sous les bombes.












 L'accueil
L'accueil