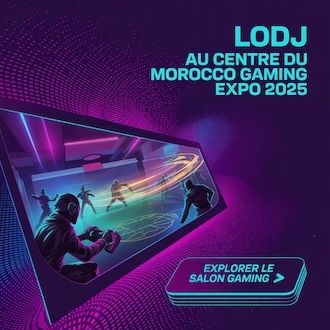A lire ou à écouter en podcast :
Par Hicham EL AADNANI Consultant en intelligence stratégique
Ce texte législatif, qui s'ancre dans l'article 99 de la Constitution algérienne, vise officiellement à structurer l'organisation, la préparation et la mise en œuvre d'une mobilisation nationale face à des défis majeurs. Présentée par les autorités comme une impérative mesure de "préparation institutionnelle" face aux "risques éventuels" dans un environnement géostratégique instable, cette loi soulève néanmoins de profondes interrogations, tant en Algérie qu'au-delà de ses frontières, notamment quant à ses implications pour les libertés publiques et la vie politique intérieure.
Est-elle une simple actualisation juridique rendue nécessaire par les mutations du monde, ou un signal politique adressé aux acteurs régionaux et internationaux ? L'analyse de ses dispositions, de son contexte d'adoption et des réactions qu'elle suscite permet d'éclairer la complexité de cette initiative.
Un cadre légal forgé dans un environnement géopolitique sous tension
L'adoption de cette loi intervient à un moment où le paysage sécuritaire du Maghreb et du Sahel est particulièrement volatile. L'instabilité chronique dans la région du Sahel, devenue le théâtre de l'activité de "groupes terroristes lourdement armés" et un "terrain de jeu des puissances étrangères", préoccupe Alger au plus haut point. Cependant, l'analyse de la situation régionale par différents acteurs et observateurs met en lumière des dynamiques complexes et des perceptions divergentes quant au rôle de l'Algérie.
Si Alger met en avant la lutte contre le terrorisme comme source principale de sa préoccupation, des critiques et des accusations émanant de certains pays de la région, comme le Mali l'a fait publiquement, y compris à la tribune de l'ONU, évoquent un soutien présumé d'Alger à certains groupes, notamment séparatistes. Par ailleurs, des analyses basées sur des sources de renseignement mentionnent l'origine algérienne de plusieurs chefs de groupes jihadistes opérant au Maghreb et au Sahel et soulèvent des questions sur une possible manipulation de ces groupes à des fins d'influence régionale.
Les tensions spécifiques avec certains pays voisins sont fréquemment citées comme des éléments ayant précipité l'adoption de cette loi. Le différend persistant autour du Sahara marocain demeure une source de friction constante. De même, un "incident frontalier impliquant la destruction d’un drone malien" par l'armée algérienne a "exacerbé les relations avec Bamako", soulignant la fragilité des équilibres régionaux. Les relations très complexes avec l'ancienne puissance coloniale, la France, marquent également ce tableau géopolitique tendu.
La rhétorique officielle algérienne ne manque pas de souligner un sentiment d'"encerclement". Le président Abdelmadjid Tebboune a lui-même évoqué un "complot hostile visant à encercler l'Algérie par l'est et le sud. Cette perception de menaces multidirectionnelles est utilisée pour justifier la nécessité pour le pays de se doter des moyens de se défendre et de se préparer à toute éventualité.
Selon ce discours, cela légitime le besoin de disposer d'un "arsenal juridique clair en matière de sécurité nationale" et de "permettre la prise de toutes les mesures nécessaires pour faire face à tous les risques éventuels", s'adaptant aux "mutations accélérées" du contexte international. L'objectif est de renforcer la capacité de l'État à faire face à un éventail de défis sécuritaires et de défense, qu'il s'agisse de menaces militaires classiques ou de crises non conventionnelles comme les urgences sanitaires.
Les dispositions clés de la loi : une mobilisation nationale étendue
La loi sur la mobilisation générale établit un cadre précis pour le déclenchement et la mise en œuvre d'une mobilisation nationale. Le déclenchement de la mobilisation générale est une prérogative du Président de la République, mais cette décision ne peut être prise qu'après consultation du Haut Conseil de Sécurité, du Président du Conseil de la Nation et du Président de l'Assemblée Populaire Nationale, et doit être formalisée lors d'une réunion du Conseil des ministres.
Les circonstances pouvant mener à une telle mesure sont définies de manière large, incluant les guerres, les menaces sécuritaires à grande échelle, les conflits armés, les agressions étrangères, les menaces à la souveraineté nationale, les crises internes ou les catastrophes naturelles. Il est important de noter que le champ d'application va au-delà des seules menaces militaires, englobant également les urgences de santé publique et autres défis majeurs pour la nation. Une "mobilisation partielle" est également prévue pour des menaces moindres.
La loi repose sur un "système global et intégré" qui implique "l’État, les secteurs public et privé, la société civile, et les citoyens". En cas de mobilisation, tous les secteurs sont tenus de poursuivre leur activité en donnant la priorité aux "besoins des forces armées". Les citoyens algériens sont soumis à un certain nombre d'obligations, dont la conformité aux ordres de mobilisation émis par les autorités et l'accomplissement des devoirs de défense nationale. La loi prévoit également la "réquisition des personnes, des biens et des services" nécessaires à l'effort de guerre, avec une obligation de s'y soumettre en échange d'une "indemnisation juste et équitable". La conscription militaire est également envisagée, avec la mobilisation des réservistes, dont le statut a été redéfini en différentes catégories.
L'impact sur l'économie nationale est également significatif. L'armée prendrait en charge la production économique et industrielle en coopération avec le ministère de l'Intérieur, avec la possibilité de réquisitionner des biens et de contrôler des secteurs clés comme l'énergie et les transports. Des restrictions économiques, telles que l'interdiction d'exporter "certaines marchandises" et la "rationalisation de la consommation de certains produits", sont prévues pour soutenir l'effort de guerre.
La loi aborde également le sort des ressortissants étrangers, prévoyant la "possibilité d’expulsion des ressortissants de pays considérés comme ennemis". Concernant le contrôle de l'information, la loi impose aux citoyens de s'interdire de "publier ou de partager" des informations "susceptibles de porter atteinte à l’opération" et de "signaler aux services de l’État la présence d’étrangers ou de personnes de pays ennemis".
Des sanctions pénales strictes sont prévues pour les contrevenants, allant de peines d'emprisonnement à des amendes importantes. La diffusion d'informations jugées nuisibles ou de "fausses nouvelles" susceptibles de provoquer des troubles est sévèrement punie, soulevant des préoccupations quant à la liberté d'expression.
Réactions et débats internes : entre patriotisme et inquiétudes
L'annonce de cette loi a suscité un large éventail de réactions en Algérie. La position officielle présente la loi comme une "mesure de bon sens, tardive mais nécessaire" face aux dangers qui menacent le pays, inscrivant cette démarche dans un cadre constitutionnel et responsable.
Cependant, au sein de la population, l'annonce a engendré une "bulle spéculative" et un "flot de commentaires" sur les réseaux sociaux. Certains citoyens expriment leur "anxiété face à ce qu’ils perçoivent comme un signe avant-coureur d’un conflit", partageant un sentiment d'"incompréhension et de crainte".
Des observateurs et des figures critiques craignent que cette loi ne soit utilisée à des "fins de contrôle interne plutôt que de défense contre des menaces extérieures". Ils estiment qu'il pourrait s'agir d'une tentative d'utiliser les citoyens comme "bouclier pour défendre le régime, plutôt que pour protéger la nation", notamment pour anticiper ou réprimer d'éventuels mouvements de protestation similaires au Hirak de 2019.
La définition large de ce qui constitue une "crise majeure" et les sanctions prévues pour la diffusion d'informations renforcent ces craintes. Le bilan de l'Algérie en matière de droits de l'homme alimente également les inquiétudes quant à une utilisation potentielle de la loi pour "faciliter la répression des libertés civiles" et restreindre les libertés fondamentales. L'absence de législation claire sur l'accès à l'information et la "relative faiblesse de l'état de droit" en Algérie sont également source de préoccupation.
Certaines régions, comme la Kabylie, ont exprimé un "refus catégorique" de cette loi, estimant qu'il s'agit d'une tentative d'impliquer les jeunes dans des conflits qui ne les concernent pas forcément.
Implications stratégiques et doctrine algérienne : signal de fermeté ou simple mise à jour ?
Au-delà des aspects juridiques et des réactions internes, la loi de mobilisation générale interroge sur la doctrine stratégique de l'Algérie et les messages qu'elle souhaite envoyer. La notion de sécurité nationale en Algérie est intrinsèquement liée à l'histoire de la lutte pour l'indépendance et à la sécurisation des frontières. La doctrine historique algérienne est marquée par les principes de "non-intervention au-delà des frontières" et de "respect de la souveraineté légitime et de la liberté des autres peuples". Cependant, face aux réalités régionales, un "équilibre subtil entre l’analyse de la menace et les moyens dont dispose l’Etat pour la contrer" est recherché.
Cette loi est perçue comme un signal adressé aux puissances régionales ; certains y voient une intention visant notamment le Maroc. Ce signal intervient dans un contexte de redéfinition des équilibres régionaux, où le récent rapprochement entre les États du Sahel (regroupés au sein de l'AES) et le Maroc, illustré par la réception de leurs ministres des Affaires étrangères par le Roi à Rabat et la proposition marocaine d'accès à l’Atlantique pour ces pays enclavés, est perçu comme un défi à l'influence traditionnelle d'Alger dans son voisinage sud.
La loi de mobilisation pourrait ainsi être interprétée comme une réaffirmation de la détermination algérienne face à ces évolutions géopolitiques, au-delà de la seule menace sécuritaire liée au terrorisme. C'est un message clair indiquant que l'Algérie est prête à "mobiliser toutes ses forces en cas de crise majeure".
Comparaison et analyse comparative
Les lois de mobilisation générale existent dans de nombreux pays, mais varient considérablement en fonction des contextes nationaux. Certains pays maintiennent une conscription active en temps de paix, d'autres n'y recourent qu'en cas de crise. La portée de la mobilisation peut également différer, allant d'une mobilisation militaire partielle à une mobilisation totale impliquant tous les aspects de la société.
Historiquement, la mobilisation a évolué, notamment avec l'introduction de la conscription au XIXe siècle. De nombreux États ont aboli la conscription en temps de paix mais conservent la possibilité de la rétablir. La décision de l'Algérie s'inscrit dans un contexte de tensions régionales et de perception accrue des menaces.
L'Algérie a elle-même connu des épisodes de mobilisation par le passé. Il y a eu des mobilisations "spéciales ou partielles" lors de la Guerre des Sables en 1963 contre le Maroc et pendant la "Décennie Noire" (1992-2002). Ces précédents historiques, ainsi que l'expérience de la guerre d'indépendance, offrent des leçons sur les défis de la mobilisation, notamment la nécessité d'unifier la population et de gérer efficacement les ressources, tout en veillant au respect des droits fondamentaux.
La nouvelle loi s'articule avec le cadre juridique algérien existant en matière de défense et de sécurité, s'appuyant explicitement sur l'article 99 de la Constitution. Elle vise à moderniser les lois existantes pour permettre une mobilisation plus efficace des ressources. Elle s'inscrit dans la hiérarchie des mesures exceptionnelles prévues par la Constitution, potentiellement après l'état d'urgence et avant la déclaration de guerre. La loi devrait compléter et renforcer le système existant sur les obligations militaires et la réserve. Cependant, des préoccupations subsistent quant à sa compatibilité avec les lois protégeant les droits et libertés fondamentaux.
Mise en œuvre : Le spectre du contrôle interne renforcé
Au-delà des justifications officielles axées sur la modernisation du cadre légal face aux menaces externes, une hypothèse majeure domine les débats et analyses : celle d'une loi principalement orientée vers un renforcement drastique du contrôle interne. Cette lecture s'inscrit dans le contexte post-Hirak, marqué par la crainte persistante d'un retour des mouvements de contestation populaire similaires à ceux de 2019. La loi de mobilisation générale est alors perçue par de nombreux observateurs comme un instrument potentiel de préservation du régime, utilisant la notion de sécurité nationale pour légitimer des mesures de contrôle social accru.
Les larges pouvoirs conférés par cette loi, censés organiser la nation face à une "crise majeure" (terme défini de manière très vaste et potentiellement interprétable), peuvent aisément être mobilisés pour faire face à des troubles d'ordre interne. La réquisition de personnes, de biens ou de services, le contrôle étendu sur l'économie et les transports, ou encore l'implication accrue de l'armée dans divers secteurs sont autant de leviers potentiels pour paralyser une société civile ou entraver l'organisation de toute forme de contestation spontanée.
L'obligation faite aux citoyens de signaler la présence d'"étrangers ou de personnes de pays ennemis" pourrait, dans un contexte de tension interne, dériver vers une incitation à la délation.
Le contrôle strict de l'information constitue l'un des piliers de cette potentielle stratégie de contrôle interne. L'obligation pour les citoyens de "s'interdire de publier ou de partager" des informations jugées nuisibles et les sanctions pénales lourdes pour la diffusion de "fausses nouvelles" ou d'informations "susceptibles de provoquer des troubles" créent un cadre juridique propice à la censure et à la répression de toute voix critique, bien au-delà du seul contexte d'un conflit armé externe avéré. Cette dimension répressive est perçue comme une réponse directe à l'expérience du Hirak de 2019, où les réseaux sociaux et la libre circulation de l'information ont joué un rôle clé dans la mobilisation et l'organisation des manifestations.
La mise en œuvre de ces dispositions suscite d'autant plus d'inquiétudes que le système juridique algérien est souvent critiqué pour la "relative faiblesse de l'état de droit" et l'absence de garanties solides en matière de libertés fondamentales. Sans mécanismes de contrôle indépendants robustes (par exemple, un accès transparent à l'information sur l'application de la loi) et une réelle séparation des pouvoirs, la loi de mobilisation est vue par ses détracteurs comme un "chèque en blanc" donné au pouvoir exécutif. Elle ouvrirait ainsi la porte à des abus de pouvoir massifs au nom de la sécurité nationale, mais en réalité dirigés contre la dissidence politique et sociale.
Dans cette perspective, l'efficacité de la loi serait moins mesurée par sa capacité à défendre le pays contre des menaces externes classiques, que par sa robustesse en tant qu'outil de maintien de l'ordre et de préservation du régime face à d'éventuelles crises internes. L'objectif implicite, selon cette analyse, serait de transformer les citoyens en "boucliers" non pas tant contre un ennemi extérieur, mais contre les tensions sociales et politiques internes.
L'adoption par l'Algérie de la loi sur la mobilisation générale est une décision d'une portée considérable, qui s'inscrit dans une histoire nationale marquée par la lutte et dans un environnement régional notoirement instable. Si le discours officiel présente cette initiative comme une étape nécessaire pour moderniser le cadre légal de défense et organiser les ressources du pays face à des menaces externes multiformes et des crises majeures, son contenu et le contexte de son adoption soulèvent de profondes interrogations quant à ses motivations réelles et ses implications.
Au-delà des impératifs de défense nationale, cette loi est largement perçue, en Algérie et par certains observateurs, comme un puissant outil potentiel de contrôle interne renforcé. Les définitions excessivement larges des circonstances déclenchant la mobilisation, les pouvoirs étendus de réquisition et de contrôle économique, mais surtout les dispositions drastiques limitant la liberté d'expression et la circulation de l'information, dans un pays où les garanties en matière d'état de droit sont jugées faibles, alimentent la crainte d'une utilisation de la loi pour museler toute contestation. Dans un contexte encore marqué par le souvenir du Hirak de 2019, cette loi pourrait ainsi être interprétée comme une mesure préventive visant à sécuriser le régime face à d'éventuels troubles intérieurs, en utilisant le prétexte de la menace extérieure.
Certes, dans le jeu complexe des rivalités au Maghreb et dans le Sahel, cette loi agit également comme un signal politique adressé aux acteurs régionaux : celui d'une Algérie déterminée à affirmer sa souveraineté et sa capacité à réagir. Cependant, l'analyse de la loi et des réactions qu'elle suscite suggère que ce signal de fermeté vise autant, sinon davantage, la population algérienne elle-même, en rappelant l'autorité de l'État et en préparant un cadre légal potentiellement répressif.
En définitive, la loi de mobilisation générale dote l'Algérie d'un arsenal juridique puissant. Sa véritable nature – est-elle avant tout un outil de préparation sincère et justifiée par les risques réels, ou un instrument politique visant prioritairement le contrôle de la société – dépendra de la manière dont elle sera appliquée. Le respect ou le contournement des libertés fondamentales, la transparence de sa mise en œuvre et la justification objective de son déclenchement futur seront les critères déterminants pour évaluer si cette loi renforce la sécurité de la nation ou simplement celle du régime, au détriment des libertés civiles.












 L'accueil
L'accueil





 De Davos à Ottawa : 2026, l’année où le Maroc doit écrire sa doctrine
De Davos à Ottawa : 2026, l’année où le Maroc doit écrire sa doctrine