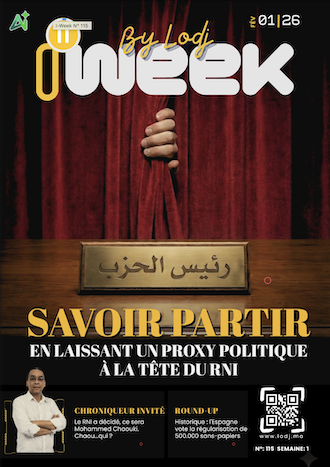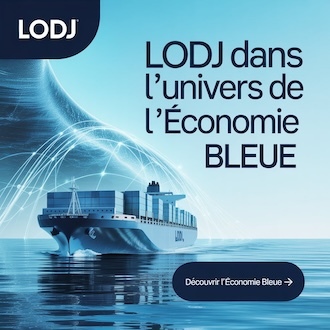Depuis le cessez-le-feu signé le 24 juin entre Téhéran et Tel-Aviv, des voix proches du président américain Donald Trump s’élèvent pour réclamer qu’il soit candidat au prix Nobel de la paix 2025. À l’origine de cette initiative, l’élu républicain Buddy Carter, qui estime que Trump a empêché « le plus grand État au monde soutenant le terrorisme d’obtenir l’arme nucléaire ».
Dans la foulée, le Pakistan a soutenu cette candidature, quelques semaines après une médiation présumée entre New Delhi et Islamabad. Mais derrière cet élan de soutien, beaucoup dénoncent une opération politique plus qu’une réelle œuvre de paix.
La proposition surprend d’autant plus que Donald Trump est loin de faire l’unanimité sur la scène internationale. S’il a proposé le cessez-le-feu entre l’Iran et Israël, c’est après avoir lui-même ordonné des frappes militaires sur des installations nucléaires iraniennes, dans la nuit du 21 au 22 juin. Une action qui, pour certains analystes, ressemble davantage à une escalade militaire qu’à une avancée pacifique.
Loin d’être un artisan de la diplomatie discrète, Trump assume une vision de la paix imposée par la force. Une doctrine héritée de Ronald Reagan, que ses partisans appellent la « paix par dissuasion ». Or, rappelle Dominique Simonnet, spécialiste des États-Unis, « le prix Nobel récompense ceux qui œuvrent pour la fraternité entre les peuples et la réduction des conflits armés, pas ceux qui les provoquent pour ensuite les stopper ».
Peut-on être faiseur de paix après avoir déclenché les hostilités ? Le cas Trump pose la question. Si le prix Nobel n’exclut pas totalement les dirigeants engagés dans des conflits, comme ce fut le cas avec Barack Obama en 2009, l’attribution à un président aussi clivant serait un séisme diplomatique et éthique.
D’ici l’annonce du prix, prévue à l’automne, la polémique ne fait que commencer. Et elle dépasse Trump lui-même : elle questionne ce que le monde veut vraiment célébrer comme œuvre de paix.












 L'accueil
L'accueil