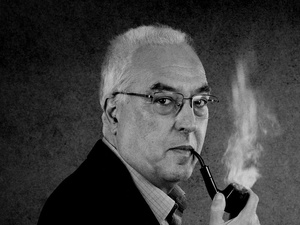L’histoire retiendra peut-être qu’en 2025, un pays riche de son pétrole, de son gaz, de ses terres rares, a préféré vendre son âme au marché… pour acheter un peu de soutien diplomatique. Car ce qui se joue aujourd’hui en Algérie dépasse les habituelles logiques d’investissement étranger : c’est un troc géopolitique de dernière chance, un chantage inversé où un régime en perte de cap tente de troquer ses ressources naturelles contre une posture diplomatique : celle de champion autoproclamé du droit des peuples, via la cause du Polisario.
Que l’Algérie décide d’ouvrir son secteur minier et énergétique à hauteur de 80 % aux capitaux étrangers n’est pas une surprise en soi. Ce qui choque, c’est le contexte, les acteurs… et les intentions. Car derrière l’ambition affichée de « relance économique » se cache une urgence géostratégique : retenir l’attention des États-Unis à l’heure où le Polisario menace d’être classé comme entité terroriste au Congrès américain.
C’est bien là l’ironie tragique du moment : un régime qui se voulait bastion du non-alignement, qui brandissait depuis soixante ans le souverainisme comme drapeau, cède désormais les clés de son sous-sol aux géants américains… pour espérer conserver un parrainage sur une cause dont le monde ne veut plus.
Des négociations avancées avec ExxonMobil, Chevron, et d’autres mastodontes du secteur ont été confirmées. Officiellement : modernisation. Officieusement : contrepartie diplomatique. À travers cette soudaine générosité extractive, Alger veut convaincre Washington de ne pas lâcher le Polisario, malgré l’évolution du consensus international en faveur du plan d’autonomie marocain.
La manœuvre est limpide : offrir l’accès à des ressources stratégiques, notamment les terres rares du Hoggar, en espérant influencer le vote des sénateurs américains. Quitte à s’agenouiller devant ceux qu’on dénonçait hier comme impérialistes.
Un jeu perdant-perdant pour les Algériens : Car au final, ce ne sont ni les diplomates ni les chefs de guerre du Polisario qui paieront les pots cassés. Ce sont les Algériens. Ceux à qui on a promis la rente éternelle, la dignité des martyrs, la souveraineté économique. Ils se retrouvent aujourd’hui avec un État qui privatise la richesse nationale pour soutenir un dossier déserté par la majorité des chancelleries sérieuses.
Pendant ce temps, les jeunes s’exilent, les routes s’effondrent, les écoles étouffent. À quoi bon tant de sacrifices si c’est pour quémander, en 2025, le soutien d’un Congrès américain de plus en plus ouvertement favorable au Maroc ?
Ce choix désespéré de marchandiser ses ressources pour acheter une cause expose aussi les limites d’une diplomatie algérienne figée dans les années 1970. À l’heure où même les puissances africaines basculent vers le réalisme stratégique, Alger s’entête dans un récit mythologique : celui d’un Sahara "colonisé", d’un front "libérateur", d’une guerre "légitime".
Mais ce storytelling ne prend plus. Ni à Paris, ni à Madrid, ni à Washington. Et ce ne sont pas quelques barils ou concessions minières supplémentaires qui inverseront la tendance.
Certains pourraient plaider que l’Algérie, en ouvrant ses gisements, ne fait que suivre une logique de compétitivité mondiale. Que vendre son gaz ou son lithium à l’Amérique vaut mieux que le laisser dormir dans les sables. Mais il y a une différence entre stratégie économique souveraine et utilisation tactique de sa richesse nationale comme pot-de-vin diplomatique.
L’Algérie pouvait vendre ses ressources pour elle-même. Elle les vend aujourd’hui pour un autre. Et pas pour son peuple.
Que l’Algérie décide d’ouvrir son secteur minier et énergétique à hauteur de 80 % aux capitaux étrangers n’est pas une surprise en soi. Ce qui choque, c’est le contexte, les acteurs… et les intentions. Car derrière l’ambition affichée de « relance économique » se cache une urgence géostratégique : retenir l’attention des États-Unis à l’heure où le Polisario menace d’être classé comme entité terroriste au Congrès américain.
C’est bien là l’ironie tragique du moment : un régime qui se voulait bastion du non-alignement, qui brandissait depuis soixante ans le souverainisme comme drapeau, cède désormais les clés de son sous-sol aux géants américains… pour espérer conserver un parrainage sur une cause dont le monde ne veut plus.
Des négociations avancées avec ExxonMobil, Chevron, et d’autres mastodontes du secteur ont été confirmées. Officiellement : modernisation. Officieusement : contrepartie diplomatique. À travers cette soudaine générosité extractive, Alger veut convaincre Washington de ne pas lâcher le Polisario, malgré l’évolution du consensus international en faveur du plan d’autonomie marocain.
La manœuvre est limpide : offrir l’accès à des ressources stratégiques, notamment les terres rares du Hoggar, en espérant influencer le vote des sénateurs américains. Quitte à s’agenouiller devant ceux qu’on dénonçait hier comme impérialistes.
Un jeu perdant-perdant pour les Algériens : Car au final, ce ne sont ni les diplomates ni les chefs de guerre du Polisario qui paieront les pots cassés. Ce sont les Algériens. Ceux à qui on a promis la rente éternelle, la dignité des martyrs, la souveraineté économique. Ils se retrouvent aujourd’hui avec un État qui privatise la richesse nationale pour soutenir un dossier déserté par la majorité des chancelleries sérieuses.
Pendant ce temps, les jeunes s’exilent, les routes s’effondrent, les écoles étouffent. À quoi bon tant de sacrifices si c’est pour quémander, en 2025, le soutien d’un Congrès américain de plus en plus ouvertement favorable au Maroc ?
Ce choix désespéré de marchandiser ses ressources pour acheter une cause expose aussi les limites d’une diplomatie algérienne figée dans les années 1970. À l’heure où même les puissances africaines basculent vers le réalisme stratégique, Alger s’entête dans un récit mythologique : celui d’un Sahara "colonisé", d’un front "libérateur", d’une guerre "légitime".
Mais ce storytelling ne prend plus. Ni à Paris, ni à Madrid, ni à Washington. Et ce ne sont pas quelques barils ou concessions minières supplémentaires qui inverseront la tendance.
Certains pourraient plaider que l’Algérie, en ouvrant ses gisements, ne fait que suivre une logique de compétitivité mondiale. Que vendre son gaz ou son lithium à l’Amérique vaut mieux que le laisser dormir dans les sables. Mais il y a une différence entre stratégie économique souveraine et utilisation tactique de sa richesse nationale comme pot-de-vin diplomatique.
L’Algérie pouvait vendre ses ressources pour elle-même. Elle les vend aujourd’hui pour un autre. Et pas pour son peuple.
Ce que l’Algérie brade aujourd’hui, ce ne sont pas que ses richesses naturelles.
C’est sa voix, son indépendance, sa posture. Pour un mirage qui se dissout sous les projecteurs du réel : celui d’un Sahara marocain, reconnu, soutenu, intégré.
Et pendant qu’Alger tente de sauver le Polisario avec du pétrole, le monde, lui, avance. Avec ou sans elle.
Et pendant qu’Alger tente de sauver le Polisario avec du pétrole, le monde, lui, avance. Avec ou sans elle.












 L'accueil
L'accueil