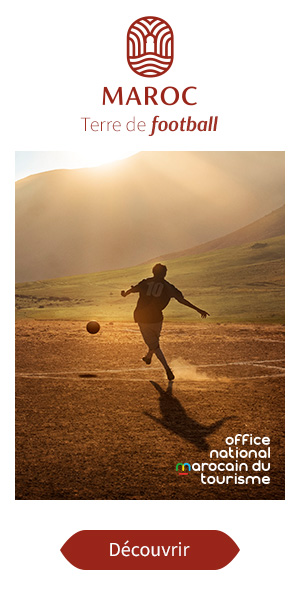UE : l’Algérie sur la liste noire
La nouvelle a traversé la Méditerranée comme un éclair. En ce mardi chargé de tension diplomatique, la Commission européenne a décidé d’ajouter l’Algérie à sa liste des juridictions considérées comme présentant des carences stratégiques dans leurs dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Une inclusion inattendue, dans un contexte où l’Algérie prétend renforcer ses relations économiques avec plusieurs partenaires internationaux, notamment européens et asiatiques.
Ce classement n’est pas un simple détail technique : il représente un signal d’alarme fort lancé par Bruxelles, incitant toutes les entités financières de l’Union européenne à exercer une vigilance accrue vis-à-vis des flux financiers impliquant Alger. C’est également une alerte symbolique qui questionne la crédibilité institutionnelle de l’Algérie sur la scène financière mondiale.
L’Algérie ne figure pas seule sur cette liste mise à jour. Elle est accompagnée de pays comme le Liban, le Venezuela, le Laos, le Kenya ou encore la Côte d’Ivoire, tous suspectés d’insuffisances dans leur lutte contre les circuits financiers illicites. À l’inverse, des pays comme les Émirats arabes unis, le Panama ou encore la Jamaïque en ont été retirés, après avoir, selon l’Union européenne, rempli les critères requis.
Il est intéressant de noter que ce n’est pas l’Europe seule qui élabore cette liste. Elle s’appuie principalement sur les évaluations du Groupe d’action financière (GAFI), organisme international dont la mission consiste à surveiller les efforts des États dans la prévention des flux financiers illégaux. Les listes du GAFI sont souvent qualifiées de “listes grises”, et l’UE les reprend en grande partie, après ses propres vérifications techniques et juridiques.
La Commission européenne insiste sur la rigueur du processus : il s’agit d’une "évaluation technique approfondie", appuyée sur une méthodologie bien définie. Visites sur place, dialogue bilatéral, collecte d’informations locales… Tout cela alimente un verdict que Bruxelles ne prend pas à la légère.
Concrètement, cette classification signifie que toutes les institutions financières européennes devront dorénavant appliquer des mesures de vigilance renforcées lors de leurs transactions avec des personnes physiques ou morales liées à l’Algérie. Ce surcroît de bureaucratie pourrait refroidir certains investisseurs ou ralentir des opérations commerciales déjà fragilisées par le contexte économique mondial.
Plus grave encore : ce classement est un coup porté à l’image de marque d’un pays qui cherche à redorer son blason sur le plan international, en particulier dans les domaines énergétique, sécuritaire et technologique. Alger a récemment multiplié les efforts pour se positionner comme un acteur stratégique dans la stabilité de l’Afrique du Nord, mais cette inclusion jette une ombre sur ces ambitions.
Il est difficile pour un observateur marocain de ne pas comparer cette décision à la situation nationale. Le Maroc n’est pas sur cette liste. Il bénéficie, malgré certaines critiques internes, d’une perception extérieure globalement favorable en matière de lutte contre le blanchiment et le financement illicite. Rabat a renforcé son arsenal législatif, modernisé ses institutions de contrôle et approfondi ses relations avec le GAFI.
La mise en cause de l’Algérie dans ce domaine, en revanche, réaffirme indirectement la position plus crédible du Maroc, notamment dans les cercles européens. Cela pourrait même réorienter certaines dynamiques de coopération financière et sécuritaire, au profit de Rabat.
La diplomatie européenne ne fait pas de déclarations tonitruantes. Elle préfère des actes discrets mais symboliques, comme ce classement. Ce genre de message est redoutablement efficace : il ne s’expose pas au débat politique frontal, mais impose un narratif implicite très clair.
Il revient maintenant à l’Algérie de lire entre les lignes et de comprendre que l’enjeu n’est pas seulement financier. C’est une invitation déguisée à repenser la gouvernance, la transparence et la coopération internationale. Et dans ce jeu d’équilibres, chaque geste, chaque réforme, chaque mot compte.
Le classement de l’Algérie par l’Union européenne parmi les pays à haut risque n’est pas une sentence irrévocable. C’est une photographie à l’instant T d’une situation préoccupante. Mais c’est aussi une chance d’amorcer une transformation profonde, si elle est saisie à temps et avec intelligence.
Il ne s’agit donc pas de pointer du doigt ou de se réjouir. Il s’agit plutôt, dans un monde interdépendant, de rappeler que la confiance ne se décrète pas : elle se bâtit, preuve après preuve.
Ce classement n’est pas un simple détail technique : il représente un signal d’alarme fort lancé par Bruxelles, incitant toutes les entités financières de l’Union européenne à exercer une vigilance accrue vis-à-vis des flux financiers impliquant Alger. C’est également une alerte symbolique qui questionne la crédibilité institutionnelle de l’Algérie sur la scène financière mondiale.
L’Algérie ne figure pas seule sur cette liste mise à jour. Elle est accompagnée de pays comme le Liban, le Venezuela, le Laos, le Kenya ou encore la Côte d’Ivoire, tous suspectés d’insuffisances dans leur lutte contre les circuits financiers illicites. À l’inverse, des pays comme les Émirats arabes unis, le Panama ou encore la Jamaïque en ont été retirés, après avoir, selon l’Union européenne, rempli les critères requis.
Il est intéressant de noter que ce n’est pas l’Europe seule qui élabore cette liste. Elle s’appuie principalement sur les évaluations du Groupe d’action financière (GAFI), organisme international dont la mission consiste à surveiller les efforts des États dans la prévention des flux financiers illégaux. Les listes du GAFI sont souvent qualifiées de “listes grises”, et l’UE les reprend en grande partie, après ses propres vérifications techniques et juridiques.
La Commission européenne insiste sur la rigueur du processus : il s’agit d’une "évaluation technique approfondie", appuyée sur une méthodologie bien définie. Visites sur place, dialogue bilatéral, collecte d’informations locales… Tout cela alimente un verdict que Bruxelles ne prend pas à la légère.
Concrètement, cette classification signifie que toutes les institutions financières européennes devront dorénavant appliquer des mesures de vigilance renforcées lors de leurs transactions avec des personnes physiques ou morales liées à l’Algérie. Ce surcroît de bureaucratie pourrait refroidir certains investisseurs ou ralentir des opérations commerciales déjà fragilisées par le contexte économique mondial.
Plus grave encore : ce classement est un coup porté à l’image de marque d’un pays qui cherche à redorer son blason sur le plan international, en particulier dans les domaines énergétique, sécuritaire et technologique. Alger a récemment multiplié les efforts pour se positionner comme un acteur stratégique dans la stabilité de l’Afrique du Nord, mais cette inclusion jette une ombre sur ces ambitions.
Il est difficile pour un observateur marocain de ne pas comparer cette décision à la situation nationale. Le Maroc n’est pas sur cette liste. Il bénéficie, malgré certaines critiques internes, d’une perception extérieure globalement favorable en matière de lutte contre le blanchiment et le financement illicite. Rabat a renforcé son arsenal législatif, modernisé ses institutions de contrôle et approfondi ses relations avec le GAFI.
La mise en cause de l’Algérie dans ce domaine, en revanche, réaffirme indirectement la position plus crédible du Maroc, notamment dans les cercles européens. Cela pourrait même réorienter certaines dynamiques de coopération financière et sécuritaire, au profit de Rabat.
La diplomatie européenne ne fait pas de déclarations tonitruantes. Elle préfère des actes discrets mais symboliques, comme ce classement. Ce genre de message est redoutablement efficace : il ne s’expose pas au débat politique frontal, mais impose un narratif implicite très clair.
Il revient maintenant à l’Algérie de lire entre les lignes et de comprendre que l’enjeu n’est pas seulement financier. C’est une invitation déguisée à repenser la gouvernance, la transparence et la coopération internationale. Et dans ce jeu d’équilibres, chaque geste, chaque réforme, chaque mot compte.
Le classement de l’Algérie par l’Union européenne parmi les pays à haut risque n’est pas une sentence irrévocable. C’est une photographie à l’instant T d’une situation préoccupante. Mais c’est aussi une chance d’amorcer une transformation profonde, si elle est saisie à temps et avec intelligence.
Il ne s’agit donc pas de pointer du doigt ou de se réjouir. Il s’agit plutôt, dans un monde interdépendant, de rappeler que la confiance ne se décrète pas : elle se bâtit, preuve après preuve.












 L'accueil
L'accueil