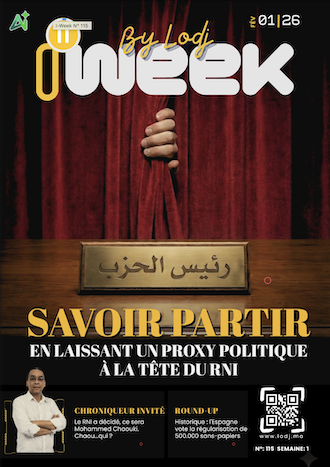Par Hajar DEHANE
Une milice saharienne dans l’orbite de Téhéran
Ainsi que le souligne un rapport publié par The Daily Telegraph le 1er juillet 2025, la République islamique d’Iran, affaiblie par les frappes israélo-américaines ayant détruit une partie de son arsenal balistique, cherche désormais à compenser ce recul stratégique par l’activation de relais périphériques. Le Front Polisario apparaît dès lors comme un levier d’influence peu exposé médiatiquement, mais parfaitement situé sur le flanc occidental du monde arabe.
Selon ce même rapport, corroboré par le Washington Post et des analyses du think tank Foundation for Defense of Democracies, le Polisario aurait reçu de l’Iran un appui logistique durable, comprenant des missiles de courte portée, des formations assurées par le Hezbollah, ainsi qu’un soutien idéologique affiché autour du narratif de la « résistance ». L’alliance se construit sur une convergence d’intérêts : pour le Polisario, il s’agit de restaurer une capacité de nuisance ; pour l’Iran, d’ouvrir un front asymétrique dans le voisinage du flanc sud de l’Europe.
Une mutation stratégique sous-estimée
Ce glissement du séparatisme vers le proxy géopolitique modifie profondément la nature du conflit. Le Polisario, autrefois présenté comme un mouvement de libération, se transforme en acteur transnational porteur de déstabilisation régionale. Les preuves, bien que partielles, s’accumulent. L’attaque de Smara a notamment visé une mission onusienne, ce qui constitue une infraction caractérisée au Droit International Humanitaire. Le silence de l’Algérie, soutien historique du Polisario, interpelle d’autant plus que ce pays avait été accusé par Rabat en 2018 d’abriter des connexions opérationnelles entre le front sahraoui, le Hezbollah et l’ambassade iranienne à Alger – accusations alors rejetées, mais désormais confortées par des sources britanniques et américaines.
À la dimension territoriale s’ajoute désormais un facteur transnational. Toujours selon The Telegraph, des projets d’attentats, visant notamment le bureau de liaison israélien à Rabat, auraient été déjoués par les services de renseignement occidentaux. Ces éléments témoignent d’un basculement inquiétant : de la guérilla localisée à l’exportation de la violence par procuration, avec un objectif assumé de déstabilisation des alliances atlantiques au Maghreb. Le Maroc, pays pivot de la coopération sécuritaire euro-africaine, devient ainsi cible prioritaire d’un axe composé d’acteurs non étatiques, financés et téléguidés par Téhéran.
Dès lors, la désignation du Polisario comme organisation terroriste par le Congrès américain ne relèverait plus d’un alignement géopolitique avec Rabat, mais d’un constat de droit fondé sur l’évolution objective du comportement du front. La menace n’est plus potentielle : elle est documentée, projetée, transfrontalière.
Le conflit saharien ne peut plus être lu à l’aune du seul différend post-colonial. L’intégration du Polisario dans l’architecture informelle de l’axe iranien transforme un dossier onusien en point de cristallisation d’un désordre régional. Si la communauté internationale persiste à considérer ce front comme un acteur politique légitime, elle risque d’ignorer les signes avant-coureurs d’une mutation insidieuse : celle d’un séparatisme instrumentalisé au service d’un agenda d’expansion stratégique.
Dans cette perspective, l’ONU et les capitales européennes sont sommées de clarifier leur position. La reconnaissance de l’initiative marocaine d’autonomie, soutenue désormais par Washington, Londres et Paris, n’est plus une préférence diplomatique ; elle devient une condition de stabilité régionale. À l’heure où le Polisario exporte ses méthodes, ses armes et son idéologie en dehors des frontières du Sahara, le maintien de l’ambiguïté ne relève plus de la neutralité mais de la négligence stratégique.












 L'accueil
L'accueil





 Donald Trump face au fascisme : procès d’intention ou avertissement historique ?
Donald Trump face au fascisme : procès d’intention ou avertissement historique ?