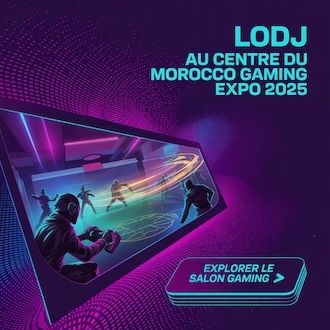« Publier d’abord, vérifier ensuite : bienvenue dans l’ère du publi-dépubli. »
Dans les rédactions des portails d’information, la tension est palpable. On n’écrit plus pour raconter, on produit pour capter. L’ennemi ? La montre. Et l’arme de survie ? Le scoop, coûte que coûte. C’est la guerre du clic, et elle ne fait aucun prisonnier.
Publier vite ou publier vrai : un dilemme cornélien
Le temps du recoupement des sources, de la vérification patiente, semble appartenir à une époque révolue. Dans les open spaces feutrés ou les studios de rédaction improvisés, chaque seconde compte. Une dépêche mal interprétée, une vidéo virale mal contextualisée, un tweet équivoque : tout peut faire « une ». Les journalistes, eux, oscillent entre excitation et angoisse.
« On vit dans une schizophrénie professionnelle permanente », confie un rédacteur d’un grand média en ligne sous couvert d’anonymat. « Si on prend le temps de vérifier, on se fait doubler. Si on publie trop vite, on prend le risque de publier une fausse information. »
Des rédactions à la dérive : entre pression commerciale et précarité éditoriale
Car il ne s’agit plus seulement d’informer, mais de survivre dans un écosystème devenu ultra-compétitif. Le clic est roi, l’algorithme est maître, la publicité dicte sa loi. Certains portails d’information, aux modèles économiques fragiles, n’ont d’autre choix que de foncer tête baissée.
Les erreurs s'accumulent, les excuses pleuvent, mais le mal est fait : une fausse information publiée, même dépubliée quelques minutes plus tard, laisse des traces. Elle est copiée, partagée, commentée. Elle vit sa vie dans les méandres des réseaux sociaux, bien après sa rétractation. Pire : elle alimente la méfiance croissante du public envers les médias.
La solution extrême : publier maintenant, vérifier plus tard
Face à cette impasse, certaines rédactions ont adopté une pratique pour le moins discutable : publier d’abord, vérifier ensuite. Une rumeur surgit ? On la publie. Si elle se révèle exacte, bingo. Sinon, on supprime discrètement l’article, ou on le « met à jour » après coup.
Cette stratégie du « publi-dépubli » est parfois déguisée derrière un vocabulaire habile : « information en cours de confirmation », « selon nos premières sources », « en attente de validation officielle ». Mais dans les faits, c’est un jeu dangereux. Car ce n’est plus le journaliste qui informe, c’est l’audience qui décide ce qui restera.
L’éthique journalistique à l’épreuve de la vitesse
Cette logique de l’urgence permanente met à rude épreuve les fondements mêmes du journalisme : la rigueur, la responsabilité, la redevabilité. La crainte d’un procès pour diffusion de fausse nouvelle est bien réelle. Mais plus insidieuse encore est la perte de crédibilité, lente, invisible, corrosive.
Certaines rédactions tentent de résister, en valorisant les formats longs, les enquêtes approfondies, les vérifications collaboratives. Mais ces initiatives sont souvent minoritaires, noyées dans un flot de contenus jetables, où l’attention du lecteur ne dépasse pas quelques secondes.
Publier sous pression est devenu la norme. Mais à force de courir après le scoop, sans filet ni boussole, les rédactions risquent de perdre leur âme. Car un média qui ne prend plus le temps de vérifier n’est plus un média : c’est une chambre d’écho algorithmique, une machine à désinformer malgré elle.
Alors, qui aura le courage de freiner ? D’imposer une pause, un retour aux fondamentaux ? Peut-être pas ceux qui gagnent aujourd’hui la course au clic. Mais peut-être ceux qui, demain, auront encore la confiance de leurs lecteurs.












 L'accueil
L'accueil





 SM le Roi ne cesse de confirmer la résilience de l’ancrage africain du Royaume
SM le Roi ne cesse de confirmer la résilience de l’ancrage africain du Royaume