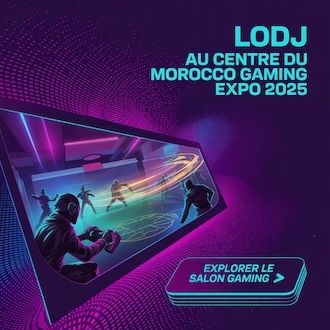A lire ou à écouter en podcast :
Ikbal Sayah, Expert en développement
Edgar Pisani, qui fut ministre de l’agriculture de la France de 1961 à 1966, avait l’habitude de dire qu’une politique qui a fonctionné est un politique qui a changé le monde. Il est indéniable que le Plan Maroc Vert, auquel a succédé Generation Green, a constitué un tournant majeur pour l’agriculture marocaine, même s’il n’a pas atteint tous ces objectifs, notamment à l’endroit des exploitants familiaux. Le même Edgar Pisani affirmait aussi que lorsque le monde change, il faut changer de politique ! A cet égard, on ne peut pas dire que les défis contemporains et largement mondialisés du changement climatique, de la raréfaction des ressources fossiles, de la prévention des maladies émergentes et de la gestion des ressources climatique ont épargné l’agriculture marocaine.
La voir et la penser autrement est le premier pas vers l’action de défense et de promotion de ce secteur vital. Comprendre les rapports de force qui s’y jouent, ses forces et ses faiblesses, ses points de dépendances, c’est aussi reconnaître la fragilité de ce qu’elle apporte : la souveraineté alimentaire. Dans cette équation complexe, l’agriculture, en proie à d’importantes modifications structurelles, ne doit pas être l’inconnue ; elle doit être un pilier du développement de l’économie marocaine.
De lourds enjeux pour l’agriculture marocaine de demain : l’enlisement ou l’émergence véritable
Au-delà de toutes ses réalités actuelles, au demeurant largement diagnostiquées et documentées, le monde agricole va aussi devoir s’adapter à des réalités futures. Elles s’affichent comme un point de bascule incontournable de l’agriculture marocaine. Les omettre serait une erreur stratégique dans l’analyse.
C’est ainsi que pour donner un cap clair au monde agricole et surmonter les défis attenants, les stratégies agricoles doivent s’inscrire dans un temps long et dans la réalité de ce qu’est l’agriculture. Trois conditions préalables à la construction d’une stratégie agricole doivent être prises en compte. En réalité, ces trois conditions mettent en avant l’impératif de prendre en compte les spécificités sociétales territoriales de l’agriculture marocaine.
La première a trait à la nécessité de faire preuve de résilience face au changement climatique. Pour rappel, le Maroc a connu sept saisons d’affilée de sécheresse chronique, induisant un manque d’eau dévastateur pour son agriculture. Ces épisodes de sécheresse ne sont pas prêts de s’interrompre avec le dérèglement climatique, qui renforce leur intensité et leur fréquence.
L’agriculture marocaine, majoritairement pluviale, est très vulnérable à ces fluctuations des précipitations. Et là où les exploitants agricoles bénéficient des technologies d’irrigation, les réserves souterraines s’épuisent vite, accentuant davantage la crise de l’eau, comme c’est le cas dans la région du Souss-Massa.
Le secteur agricole, premier usager des ressources en eau puisqu’il en consomme 85%, doit donc augmenter radicalement son efficacité d’utilisation en eau même si d’importants investissements ont été effectués pour couvrir les besoins agricoles en eau, mais aussi la demande des autres secteurs, elle aussi de plus en plus pressante (eau domestique, urbanisation, industrialisation et tourisme). Dans ces conditions, la transition vers une agriculture durable et responsable ne relève plus du choix. Elle est impérative.
La recherche agronomique s’impose alors comme une priorité incontournable pour une agriculture plus résiliente. Le changement climatique et la réponse génétique et technologique qu’il requiert impliquent de forts investissements dans la recherche agronomique. Avec l’INRA, le Maroc a une ancienne tradition en la matière et ces centres régionaux de recherche forment un maillage territorial efficace. De même, la recherche privée commence à occuper une place de plus en plus importante.
Cependant, malgré ces acquis, les subventions publiques accordées à la recherche agronomique sont encore limitées et le Maroc pourrait accuser dans les prochaines années des retards significatifs faute d’investissements. En 2025, le budget d’investissement du département de l’Agriculture s’établit à 14,21 milliards de dirhams, dont 468 millions de dirhams, soit 46,8 millions de $, pour l’éducation, la formation et la recherche. Des montants plus conséquents concernent des programmes associant le public et le privé, comme les 1,5 milliards de dirhams prévus pour développer l’agriculture biologique, ou établis dans le cadre de la coopération internationale.
Comparaison n’est pas raison, mais tout de même. La France dépense près de 2,2 milliards de $ dans la recherche publique et privée, les Etats-Unis investissent plus de 4 milliards de $ de fonds publics, sans compter les 500 millions alloués chaque année par la fondation Bill et Melinda Gates. Quant à elle, la Chine, elle investit plus de 10 milliards chaque année dans la recherche agronomique.
Au Maroc, la sélection variétale est un levier essentiel de la résilience des agriculteurs marocains à la sécheresse. En outre, la recherche agronomique fait continuellement des progrès pour préserver le patrimoine génétique national, en améliorant à la fois la résistance et la productivité des cultures telles que l’olivier, le palmier-dattier ou le cactus. Un investissement plus soutenu dans la recherche agronomique peut permettre au Maroc d’être plus compétitif à l’international, à l’instar de son voisin ibérique qui a réussi à dominer le marché européen de la fraise en innovant avec des variétés demandant moins de ressources et plus adaptées à ses conditions climatiques.
Cette modernisation de la recherche agronomique marocaine devra impérativement porter sur son système de gouvernance. L’expérience d’autres centres d’innovation très compétitifs, comme celui des Pays-Bas, en témoigne. Ce pays a une approche intégrée et collaborative de la recherche, où la synergie entre les universités, les entreprises, les instituts de recherche et les pouvoirs publics a toute sa place.
Les instituts de recherche collaborent souvent avec des startups et des entreprises établies pour développer de nouvelles technologies et méthodes de culture plus efficaces et durables. Conjointement, le gouvernement néerlandais organise et dynamise les partenariats public-privé et oriente des financements vers la recherche et le développement en agronomie. Les centres d'innovation et les clusters, la Food Valley par exemple, rassemblent des entreprises, des chercheurs et des entrepreneurs pour collaborer et assurer un transfert efficace des solutions vers les agriculteurs. Ainsi, cette dynamique public-privé permet aux Pays-Bas de connaître un véritable accroissement de la puissance par l’agriculture, à tel point qu’ils sont aujourd’hui la troisième puissance agricole exportatrice au niveau mondial.
Enfin, nos chercheurs devront également prendre davantage en compte la santé de nos sols. La résilience des cultures face aux aléas climatiques en dépend directement. Le suivi de la santé des sols peut permettre d’identifier pour chaque matière agricole les pratiques agronomiques assurant le meilleur avenir à nos sols, et ce dans le cadre d’itinéraires techniques proposés aux agriculteurs. Le sol est le premier actif de l’agriculteur : c’est la garantie de ses revenus futurs ainsi qu’un levier d’innovation et de compétitivité pour notre agriculture.
Cette transition vers une agriculture durable s’insère aussi dans une équation complexe, liée à un contexte international qui se géopolitise de nouveau. En effet, du fait de la guerre en Ukraine et de l’accentuation des tensions militaires au Moyen-Orient, la question énergétique a nettement crû en importance dans la gestion des systèmes agricoles. L'énergie fossile est omniprésente dans l’agriculture et la hausse de son prix au courant de ces dernières années est de nature à déstabiliser les chaînes de valeur agricoles et agroalimentaires. Aussi, réduire le poste de charges lié à l’énergie est indispensable pour maintenir notre agriculture compétitive face à des pays qui la payent moins chère.
En l’occurrence, la biométhanisation offre un moyen efficace de réduire la dépendance aux énergies fossiles dans l'agriculture. Une feuille de route ambitieuse a été mise en place par l’Etat marocain pour développer ce procédé à l’horizon 2030. Il contribue également à la gestion durable des déchets, réduit les émissions de gaz à effet de serre et favorise le développement d'une économie circulaire dans le secteur agricole. La biométhanisation peut cependant entrer en contradiction avec l’intérêt alimentaire de l’agriculture.
Outre la nécessité économique de réduire le coût des charges et de l'énergie, la réduction au maximum de la dépendance aux énergies fossiles s’impose par nécessité environnementale. Cela invite à repenser l'articulation de toute la logistique autour du monde agricole. Aujourd’hui, l’essentiel des marchandises agricoles sont transportées par camions routiers. Repenser le réseau ferroviaire pour lui permettre de prendre en charge les flux logistiques agricoles pourrait alors être une solution d’efficience dans les prochaines années, même si cela nécessite des investissements considérables.
Quoiqu’il en soit, la hausse sans doute inéluctable des coûts de l'énergie finira par provoquer des répercussions conséquentes sur la structure intrinsèque de l’agriculture. Une évolution des pratiques agricoles, dans les industries agroalimentaires et dans le réseau de distribution, finira alors par s’imposer. Il faut donc s’attendre à une recomposition structurelle de l’agriculture dans les prochaines années, modifiant en profondeur les flux logistiques et les chaînes de valeur agricoles.
Enfin, la troisième condition préalable a trait à l’indispensable intégration des nouvelles générations dans la mutation de l’agriculture. Le renouvellement générationnel des agriculteurs est en effet un défi de taille pour l’agriculture. En 2016, selon le RGA, il y avait 1,6 million d’exploitations. Elles faisaient en moyenne 5,4 hectares, ce qui représente une taille dérisoire par rapport aux exploitations agricoles dans plusieurs pays d’Europe. Le maintien d’une agriculture familiale et à taille humaine a notamment été possible grâce à la succession des terres dans un cadre familial, car aujourd’hui encore, la surface agricole est principalement détenue par des exploitants familiaux.
Néanmoins, les agriculteurs marocains prennent de l’âge. Ce phénomène est particulièrement marqué dans les petites exploitations familiales et dans une dizaine d’années, une large partie d’entre elles sera sans relève, au point de menacer la viabilité de milliers d’entre elles. L’urbanisation rapide de notre pays et l’élévation du niveau d’instruction dans les zones rurales ont par ailleurs modifié les aspirations des jeunes générations, désormais moins enclines à perpétuer une activité jugée incertaine. Cette désaffection accentue le morcellement des terres, réduisant encore leur rentabilité.
Ce contexte ne signifiera pas pour autant la fin de l’agriculture, mais celle d’une forme d’agriculture qui sera sans nulle doute accompagnée d’une réorganisation en profondeur des structures d’exploitations et des modes d’exercice du métier d’agriculteur. Il ne s’agit nullement de laisser l’initiative seulement à des investisseurs privés, strictement mus par des logiques et rationalités économiques et financières, davantage portés vers les productions destinées à l’exportation, c’est-à-dire des segments de marché de marché haut de gamme.
Ce dénaturement de l’agriculture marocaine peut alors conduire à une évanescence de notre souveraineté alimentaire. Il faut donc bien se garder de l’érosion progressive du tissu agricole traditionnel qui, s’il parvient à attirer les jeunes, peut être constituer une composante essentielle de la résilience alimentaire du pays.
Dès lors, le Maroc doit pouvoir compter sur le renouvellement des générations pour accélérer la transformation du secteur et favoriser des formes d’innovation plus radicale. D’ailleurs, c’est pleinement conscient de cette évolution que l’Etat a inscrit dans sa stratégie agricole décennale, le Plan « Green Génération 2020-2030 », une série de mesures destinées à attirer de nouveaux acteurs dans le secteur. Parmi elles, l’incitation à la transmission des exploitations à des entrepreneurs agricoles, la consolidation du foncier pour limiter l’émiettement des parcelles, ainsi que l’élargissement de la couverture sociale à 400 000 familles rurales. Un programme de formation prévoit par ailleurs l’accompagnement de 350 000 jeunes agriculteurs et investisseurs afin de favoriser l’émergence d’un modèle plus résilient et productif.
« Green generation » a alors pour ambition de faire émerger une nouvelle génération d’entrepreneurs ruraux, non forcément issus du milieu agricole, mieux formés, peut-être plus féminisés, davantage ouverts aux nouvelles pratiques agricoles et à la commercialisation en circuit court. L’agriculture traditionnelle, mieux organisée dans le cadre de coopératives et groupements agricoles productifs et assurant l’ancrage des populations rurales dans les territoires, coexistera alors, sans céder sa place, avec l’entreprise agricole qui vise à répondre à une demande mondiale, et avec une forme inédite de micro-exploitations qui empruntent les codes de la startup. Cette situation va constituer une véritable révolution culturelle dans le monde rural marocain, en donnant naissance à une classe moyenne agricole véritablement entrepreneuriale.
Il s’agit possiblement d’une tendance de fond à consolider pour qu’à terme, le secteur agricole puisse concurrencer les opportunités offertes par l’économie urbaine. Les fonctionnaires du ministère de l’agriculture devront, à l’avenir, être très attentifs à ce renouvellement escompté des générations d’agriculteurs pour qu’il soit l’occasion d’une accélération indispensable vers l’agriculture durable. C’est en effet souvent à partir de signaux faibles que se font les grandes transformations et innovations !
Rien n’est perdu ! Il suffit de prendre conscience que le système agricole marocain se trouve à la croisée des chemins, face à son destin. Tant en raison de sa vulnérabilité que pour rôle stratégique dans la résilience globale, le secteur de l’agriculture figure en première ligne pour affronter des défis de taille : changement climatique, crise énergétique, préservation des ressources, renouvellement générationnel, santé des individus, préservation des sols et de la biodiversité et aussi mise en avant d’une coopération Sud-Sud équilibrée, pour favoriser l’émergence de solutions concrètes, portées par l’innovation et adaptées aux réalités des territoires.
Cela impose à notre pays de définir une stratégie claire, réaliste, qui s’inscrive dans une vision de long terme, qui intègre les questions de la durabilité agricole en faisant preuve de résilience face au changement climatique, à la volatilité des marchés et des charges d’exploitations et en intégrant les nouvelles générations dans la mutation de l’agriculture. En réalité, ces trois composantes mettent en avant la nécessité de prendre en compte les spécificités sociétales de notre agriculture.
Dans ce contexte, l’inclusion des petits producteurs et le renforcement de leur réactivité face à l’évolution des chaines de valeurs alimentaires sont essentielles. Leur accompagnement s’impose devient impératif, notamment pour l’adoption des nouvelles technologies ou le développement des organisations de producteurs.
Il ne s’agit donc pas de faire évoluer notre modèle agricole à la marge, mais d’être proactif et inventif pour garantir une agriculture résiliente et durable. L’innovation sera sans doute un outil incontournable pour accompagner l’adaptation de nous différents systèmes agricoles. Dans les années qui viennent, on devrait pouvoir évoquer non pas le Salon international de l’agriculture de Meknès, mais le Salon international des agricultures et de l’alimentation durable.
Ikbal Sayah,
Expert en développement, il est directeur du pôle des études générales à l’ONDH.












 L'accueil
L'accueil





 La fin des études n’aura pas lieu : clarifier le malentendu de l’intelligence artificielle
La fin des études n’aura pas lieu : clarifier le malentendu de l’intelligence artificielle