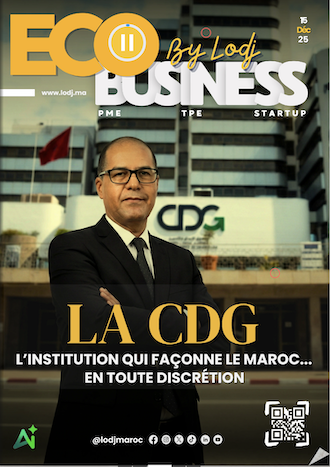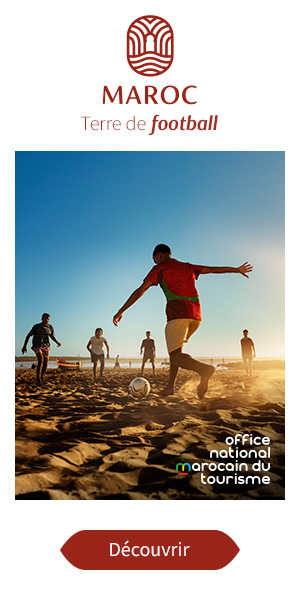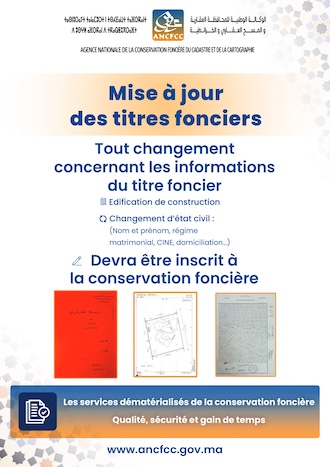La famille : père du gendre de Trump ambassadeur des États-Unis en France
Le Sénat américain a validé, à une courte majorité, la nomination de Charles Kushner, magnat de l’immobilier et père de Jared Kushner — le gendre de Donald Trump — en tant qu’ambassadeur des États-Unis en France. Une décision hautement symbolique et politiquement explosive, compte tenu du passé judiciaire de ce proche du clan Trump.
Charles Kushner n’est pas un inconnu du grand public. Fondateur du puissant groupe immobilier Kushner Companies, il avait été condamné en 2005 à deux ans de prison pour évasion fiscale, manipulation de témoins et financement illégal de campagnes politiques. À l’époque, le scandale avait éclaboussé la côte Est et terni durablement son image. Mais en 2020, il bénéficiait d’une grâce présidentielle accordée par Donald Trump lui-même, dans un geste qui avait déjà soulevé l’indignation des milieux juridiques et de certains élus.
Sa nomination à Paris s’inscrit dans une nouvelle dynamique de reconquête diplomatique voulue par les conservateurs américains, et plus particulièrement par Trump, qui n’a jamais caché son intention de récompenser ses fidèles. Ce choix suscite cependant de nombreuses critiques, notamment chez les démocrates, mais aussi parmi certains républicains modérés qui y voient une confusion des genres entre loyauté personnelle et intérêts nationaux.
À Paris, la désignation de Charles Kushner est accueillie avec circonspection. Si la diplomatie française s’abstient pour l’instant de tout commentaire officiel, plusieurs analystes évoquent une « ère Kushner » qui risque d’accentuer la personnalisation des relations bilatérales au détriment d’un dialogue institutionnel. Pour les milieux diplomatiques, c’est surtout le manque d’expérience de Kushner dans les affaires internationales qui interroge.
Le choix d’un ambassadeur à la réputation controversée dans une capitale aussi stratégique que Paris pose ainsi une question de fond : la diplomatie américaine est-elle en train de devenir une vitrine pour les proches du pouvoir, au mépris des règles de déontologie et des traditions républicaines ? Ou s’agit-il d’un simple retour à une pratique vieille comme la République : celle de confier les postes de prestige aux mécènes et aux amis politiques ?
Charles Kushner n’est pas un inconnu du grand public. Fondateur du puissant groupe immobilier Kushner Companies, il avait été condamné en 2005 à deux ans de prison pour évasion fiscale, manipulation de témoins et financement illégal de campagnes politiques. À l’époque, le scandale avait éclaboussé la côte Est et terni durablement son image. Mais en 2020, il bénéficiait d’une grâce présidentielle accordée par Donald Trump lui-même, dans un geste qui avait déjà soulevé l’indignation des milieux juridiques et de certains élus.
Sa nomination à Paris s’inscrit dans une nouvelle dynamique de reconquête diplomatique voulue par les conservateurs américains, et plus particulièrement par Trump, qui n’a jamais caché son intention de récompenser ses fidèles. Ce choix suscite cependant de nombreuses critiques, notamment chez les démocrates, mais aussi parmi certains républicains modérés qui y voient une confusion des genres entre loyauté personnelle et intérêts nationaux.
À Paris, la désignation de Charles Kushner est accueillie avec circonspection. Si la diplomatie française s’abstient pour l’instant de tout commentaire officiel, plusieurs analystes évoquent une « ère Kushner » qui risque d’accentuer la personnalisation des relations bilatérales au détriment d’un dialogue institutionnel. Pour les milieux diplomatiques, c’est surtout le manque d’expérience de Kushner dans les affaires internationales qui interroge.
Le choix d’un ambassadeur à la réputation controversée dans une capitale aussi stratégique que Paris pose ainsi une question de fond : la diplomatie américaine est-elle en train de devenir une vitrine pour les proches du pouvoir, au mépris des règles de déontologie et des traditions républicaines ? Ou s’agit-il d’un simple retour à une pratique vieille comme la République : celle de confier les postes de prestige aux mécènes et aux amis politiques ?












 L'accueil
L'accueil