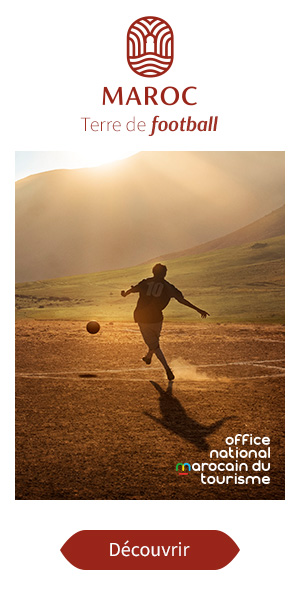Une attaque massive et simultanée sur le sol russe : Quels avions ont été touchés ? Des Tupolev à longue portée
Le 1er juin 2025, le Service de sécurité ukrainien (SBU) aurait mené une attaque par drones d’une ampleur sans précédent, ciblant quatre aérodromes militaires russes situés dans des zones qualifiées de « reculées ». Selon les médias ukrainiens, qui se réfèrent à une source haut placée au sein du SBU, plus de 40 bombardiers stratégiques russes auraient été « mis hors d’usage ou endommagés », dans ce qui pourrait représenter l’un des coups les plus significatifs portés par l’Ukraine sur le territoire russe depuis le début du conflit en février 2022.
Si aucune confirmation n’émane du Kremlin, plusieurs analystes militaires estiment qu’il pourrait s’agir des Tupolev Tu-95 et Tu-160, ces bombardiers lourds capables de transporter des missiles de croisière à capacité nucléaire. Ce type d’appareil joue un rôle central dans la stratégie russe de frappes à distance, souvent utilisées pour viser les infrastructures énergétiques et civiles ukrainiennes.
Dès lors, les implications tactiques et symboliques sont considérables : endommager une flotte stratégique, bien que protégée loin du front, montre l’évolution fulgurante de la capacité de frappe à longue distance de l’Ukraine. Si ce chiffre de 40 appareils s’avère exact, c’est un revers logistique majeur pour Moscou, difficile à compenser rapidement.
Cette opération aurait été rendue possible grâce à l’utilisation de drones à longue portée modifiés localement, capables de voler des centaines de kilomètres sans être interceptés par les défenses russes. La question cruciale est la suivante : comment ces drones ont-ils pu atteindre des aérodromes si éloignés du front, et souvent gardés par les systèmes anti-aériens S-300 ou S-400 ?
Les experts parlent d’une rupture technologique majeure, rendue possible par des partenariats avec des entreprises civiles, voire une aide occidentale indirecte. Depuis plusieurs mois, les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Allemagne ont investi massivement dans les capacités ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) de l’Ukraine, permettant des frappes plus précises et audacieuses.
Le fait que cette opération soit revendiquée par le SBU et non par l’armée régulière ukrainienne (AFU) en dit long sur la nature hybride du conflit. Le Service de sécurité ukrainien, souvent comparé à un mix entre la CIA et le Mossad, a renforcé ces derniers mois ses capacités offensives, en menant des opérations en territoire russe ou en Crimée.
Cette opération montre également une coordination entre les services de renseignement, les opérateurs de drones et les unités de sabotage à distance, signalant une montée en puissance du modèle ukrainien de guerre décentralisée, agile, et technologiquement sophistiquée.
Silence à Moscou : malaise ou réorganisation ?
Aucune déclaration officielle russe n’a, pour l’heure, confirmé ou nié l’attaque. Ce silence pourrait s’expliquer par le choc stratégique de l’opération, la difficulté d’en évaluer immédiatement les pertes, ou la volonté d’éviter un effet de panique interne.
Mais si l’attaque est confirmée, cela ouvrirait la voie à une escalade dangereuse, la Russie pouvant répondre par des représailles massives contre les villes ukrainiennes ou les infrastructures énergétiques.
Si aucune confirmation n’émane du Kremlin, plusieurs analystes militaires estiment qu’il pourrait s’agir des Tupolev Tu-95 et Tu-160, ces bombardiers lourds capables de transporter des missiles de croisière à capacité nucléaire. Ce type d’appareil joue un rôle central dans la stratégie russe de frappes à distance, souvent utilisées pour viser les infrastructures énergétiques et civiles ukrainiennes.
Dès lors, les implications tactiques et symboliques sont considérables : endommager une flotte stratégique, bien que protégée loin du front, montre l’évolution fulgurante de la capacité de frappe à longue distance de l’Ukraine. Si ce chiffre de 40 appareils s’avère exact, c’est un revers logistique majeur pour Moscou, difficile à compenser rapidement.
Cette opération aurait été rendue possible grâce à l’utilisation de drones à longue portée modifiés localement, capables de voler des centaines de kilomètres sans être interceptés par les défenses russes. La question cruciale est la suivante : comment ces drones ont-ils pu atteindre des aérodromes si éloignés du front, et souvent gardés par les systèmes anti-aériens S-300 ou S-400 ?
Les experts parlent d’une rupture technologique majeure, rendue possible par des partenariats avec des entreprises civiles, voire une aide occidentale indirecte. Depuis plusieurs mois, les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Allemagne ont investi massivement dans les capacités ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) de l’Ukraine, permettant des frappes plus précises et audacieuses.
Le fait que cette opération soit revendiquée par le SBU et non par l’armée régulière ukrainienne (AFU) en dit long sur la nature hybride du conflit. Le Service de sécurité ukrainien, souvent comparé à un mix entre la CIA et le Mossad, a renforcé ces derniers mois ses capacités offensives, en menant des opérations en territoire russe ou en Crimée.
Cette opération montre également une coordination entre les services de renseignement, les opérateurs de drones et les unités de sabotage à distance, signalant une montée en puissance du modèle ukrainien de guerre décentralisée, agile, et technologiquement sophistiquée.
Silence à Moscou : malaise ou réorganisation ?
Aucune déclaration officielle russe n’a, pour l’heure, confirmé ou nié l’attaque. Ce silence pourrait s’expliquer par le choc stratégique de l’opération, la difficulté d’en évaluer immédiatement les pertes, ou la volonté d’éviter un effet de panique interne.
Mais si l’attaque est confirmée, cela ouvrirait la voie à une escalade dangereuse, la Russie pouvant répondre par des représailles massives contre les villes ukrainiennes ou les infrastructures énergétiques.












 L'accueil
L'accueil